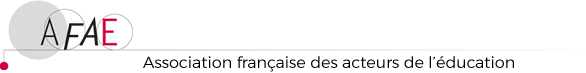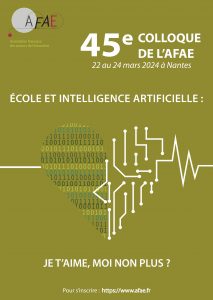
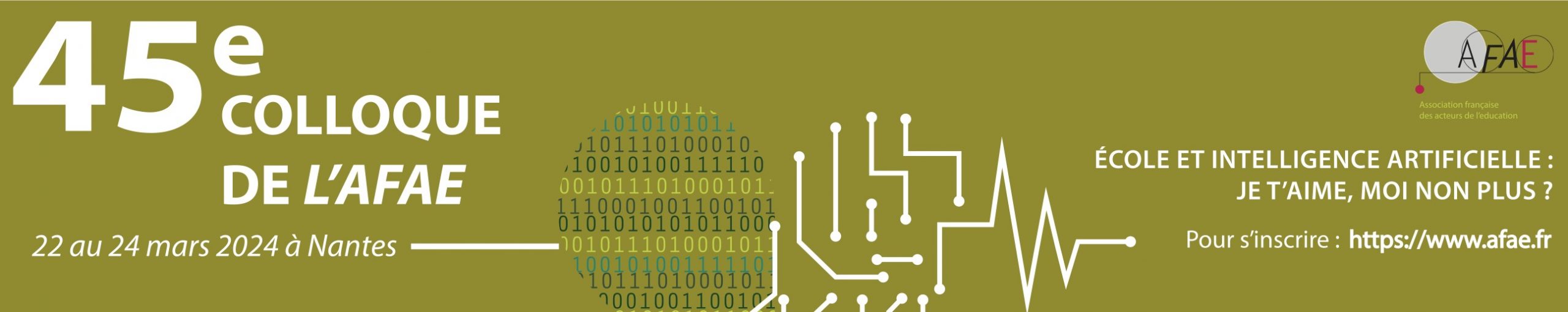
Bibliographies
Retrouvez ici les conseils bibliographiques pour bien préparer le colloque. Une grande partie des ouvrages cités seront disponibles à la vente durant le colloque auprès de notre librairie partenaire.
La présente bibliographie a été établie par XXX.