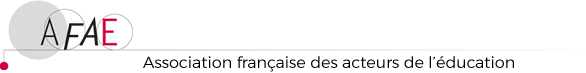Complément du numéro 187
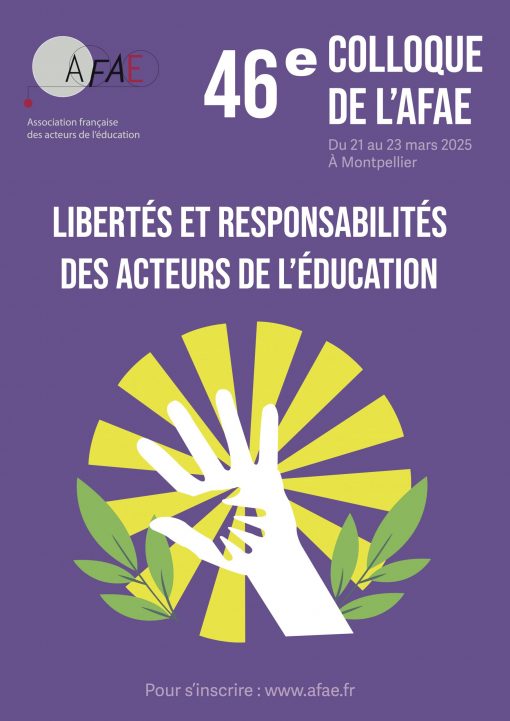
Article en complément du numéro 187 “Libertés et responsabilités des acteurs de l’éducation” (2025-3)
Un regard sur l’agir enseignant dans la classe, l‘établissement : quelles responsabilités, autonomie, liberté aujourd’hui ? Un métier en crise d’identité ?
Dominique BUCHETON
Posons le cadre : l’enseignant expert ou néo titulaire, voire vacataire, inscrit son agir dans des contenus de programmes nationaux, voire dans les prescriptions qui les accompagnent, par exemple les évaluations nationales et internationales imposées, les groupes de besoins imposés.
Il inscrit son action dans le fonctionnement d’un système scolaire imposé : cycles, classe, matières, horaires, etc. Un agir qui contribue pour une part importante aux tris, orientations futures des élèves par le biais des examens et évaluations diverses auxquels il doit les préparer et qu’il corrige. Une lourde responsabilité, même si elle est partagée par une équipe.
L’enseignant, inscrit aussi son agir dans un contexte scolaire qu’il n’a pas toujours choisi : homogénéité ou hétérogénéité sociale, culturelle des élèves, dans des locaux, du matériel plus ou moins propice aux apprentissages, dans une équipe pédagogique plurielle, plus ou moins consensuelle, dans un style spécifique de direction, dans des usages, projets, et pratiques scolaires de l’établissement, enfin dans des gestes de métier, une culture héritée plus ou moins novatrice, ou conservatrice.
Une liberté bien encadrée !
Liberté, autonomie à partir de quels principes ?
Les enseignants et professionnels éducatifs du service public sont censés inscrire leur agir dans des principes éthiques, éducatifs et citoyens : œuvrer à la liberté, l’émancipation des esprits, à l’égalité des droits et à l’éducation de tous les enfants, à la fraternité.
L’évolution aggravée des inégalités socio-culturelles dans les résultats internationaux et enquêtes montrent à l’évidence que ces principes sont de moins en moins au cœur du métier. Sont-ils empêchés ? Pourquoi ? Où le bât blesse-t-il ? Qui est responsable ? Le système et ses fonctionnements ? L’ensemble des acteurs du système, y compris les parents, qui aujourd’hui pour nombre d’entre eux ont perdu confiance en l’école publique ? Le contexte de crise sociétale ?
Un métier enseignant en panne, en souffrance : la grande machine éducation nationale est « grippée ».
Tout métier se dégrade quand le sens se perd. À l’hôpital comme à l’école. Les symptômes se multiplient : repli de chacun dans sa classe, réunions, formations qu’on évite, dépressions, arrêts maladie, frictions nombreuses entre élèves, chefs d’établissement en burn out qui ne savent plus où trouver de l’aide pour résoudre les conflits qui se multiplient avec les familles.
Enseigner n’attire plus, les démissions se multiplient et pas seulement pour des raisons financières. Le métier a perdu sa boussole : la confiance dans le pilotage institutionnel qu’abîment un peu plus la valse des changements de programmes, des formes et contenus d’examen, etc.
Ajoutons à cela les effets prévisibles des nouveaux programmes des cycles 2 et 3. Récemment publiés et applicables sans formation à la rentrée 2025, ils sont découpés en une « inflationnite » aigüe (70 pages) de rondelles de mini objets de savoir hiérarchisés, allant toujours du simple au complexe, infligeant un tempo stakhanoviste infernal tant aux élèves qu’aux enseignants.
Quelle place reste-t-il alors aux équipes d’enseignants pour exercer leur liberté pédagogique et leur responsabilité dans le choix des modalités pédagogiques adaptées à leurs élèves ou pour imaginer des projets donnant du sens aux apprentissages ?
Cerise sur le gâteau : plus besoin de beaucoup de formation, plus besoin de réfléchir avec le modèle simpliste, mécaniste, pseudo cognitif de la pédagogie dite « explicite » et son système de « modelage » de la pensée des élèves. Un modèle décidé et imposé par le CSP (Conseil supérieur des programmes) sans concertation véritable des associations professionnelles, des chercheurs en sciences de l’éducation, des syndicats.
Les logiciels pour un modelage en kit des pratiques sont déjà sur le marché pour mettre en service cette pseudo théorie universelle de l’apprentissage.
Rêvons, imaginons, ripostons ! Nous avons déjà les ressources
Si la crise du système éducatif est profonde (gouvernance, programmes, recrutements, formation, classements internationaux, injustices socio scolaires), nombreux sont pourtant les établissements, les enseignants, les collectifs, les chefs d’établissement qui réussissent à trouver leur autonomie singulière et collective pour agir de manière efficiente en responsabilité et conscience éthique.
Des établissements REP ont même des résultats brillants, inattendus. Des lycées innovent pour mieux accompagner les élèves, mènent des projets d’enseignement, collectifs, audacieux. Les témoignages divers recueillis dans l’atelier parmi les chefs d’établissements ou formateurs, français et belges ont ouvert les portes de l’espérance.
Les maîtres mots en sont : dispositifs longs de concertation, de recherche-action-formation. Ils permettant la construction de vrais collectifs, en prise avec les problèmes spécifiques de l’établissement. Ils organisent des événements culturels, sportifs, permettant de reconstruire des convivialités, des fraternités, des rencontres qui rassemblant élèves, enseignants, parents, et tout le personnel éducatif, etc. Oui, nous avons les ressources humaines intellectuelles, culturelles pour redresser la barre.
Discutons, résistons, réinventons l’école de demain. Ensemble.[1]
Dominique BUCHETON,
Professeure honoraire, université de Montpellier
[1] Texte issu d’un atelier du 46e colloque national de l’AFAE en 2025.
Personne ressource : Dominique Bucheton. Animation : Éric Biset