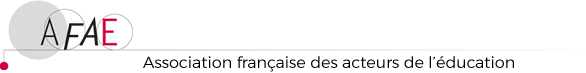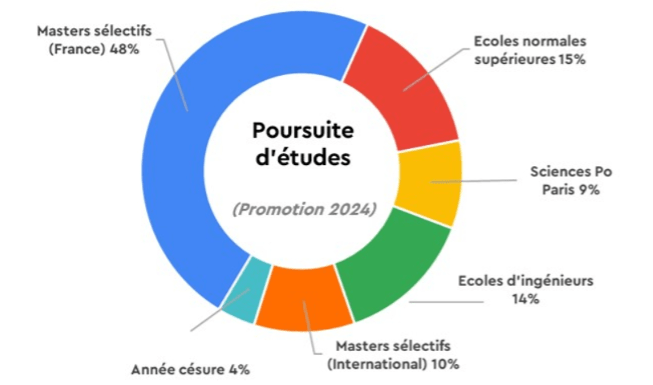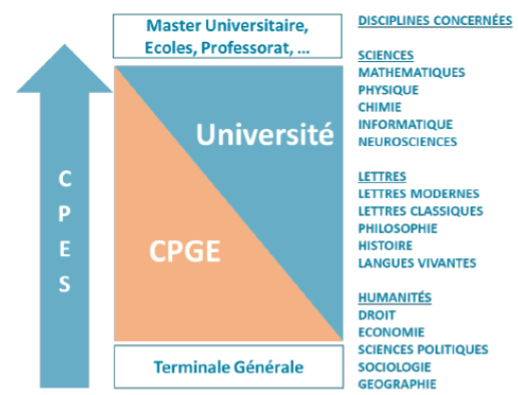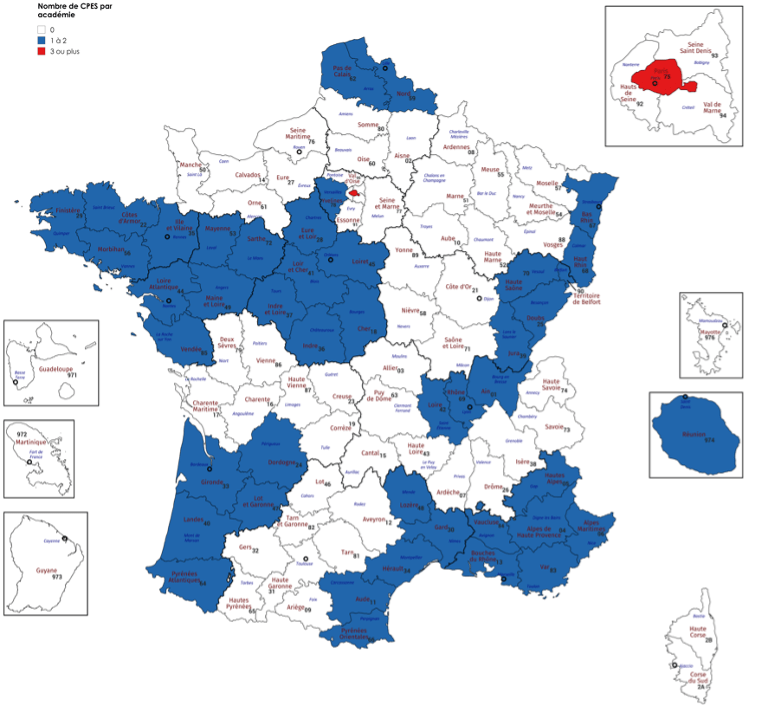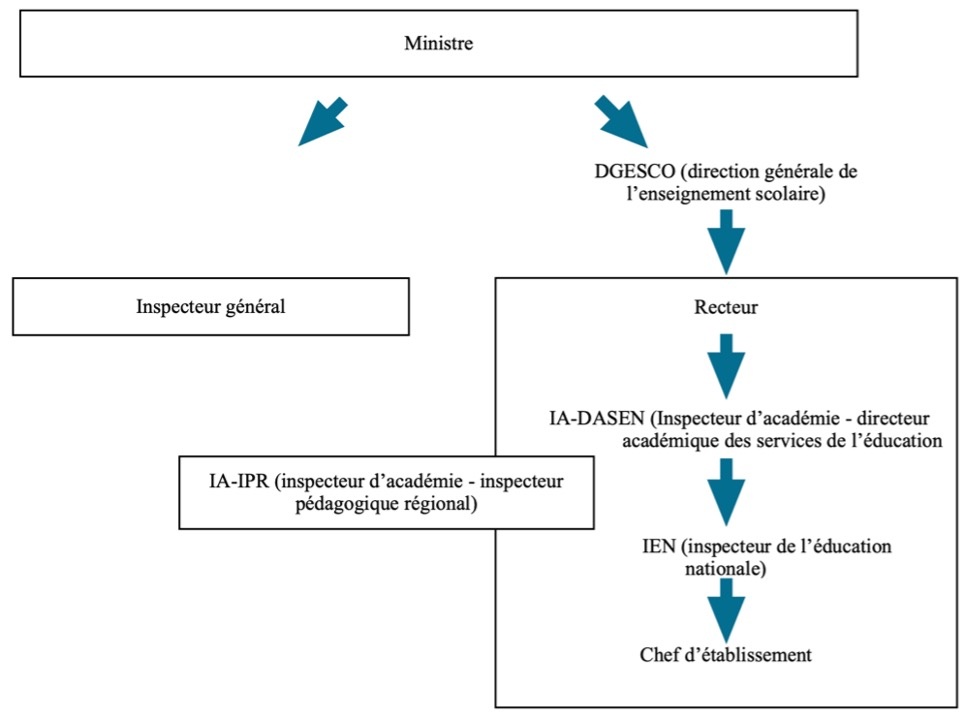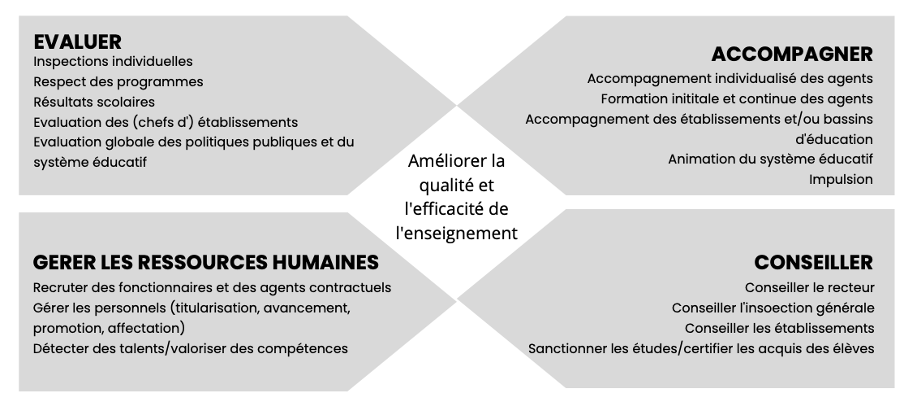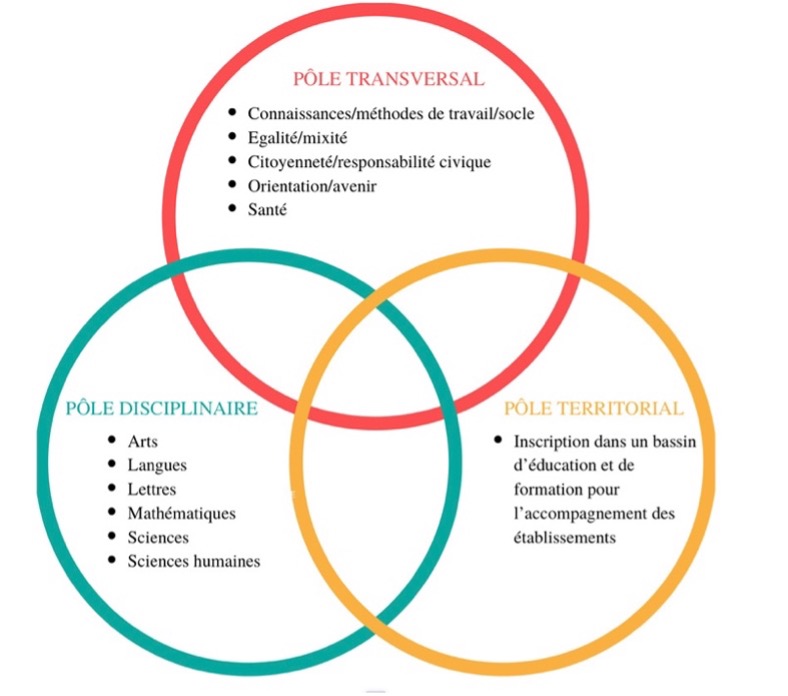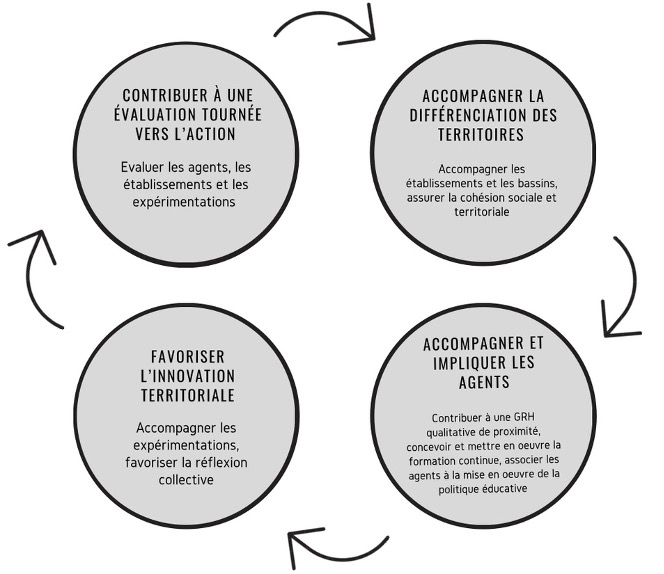Regards croisés sur des parcours en rupture
Natacha FERLAC
Cécile-Eugénie CLOT
Fabien MARMONIER-LECHAT
Résumé :
Cet article repose sur une démarche qui s’est attachée à construire avec les jeunes rencontrés une relation d’écoute et de confiance afin de donner toute sa place à leur parole, dont sont conservées l’authenticité et la spontanéité. Le corpus a été recueilli auprès de jeunes en Service militaire volontaire (SMV), de mineurs incarcérés en quartier mineurs (QM) de maison d’arrêt et de jeunes des Missions locales (ML). L’échantillon, numériquement limité, est représentatif pour une démarche qualitative, qui repose sur l’analyse approfondie des verbatims, non sur la quantification des récurrences. Les entretiens exploratoires, d’une durée d’environ quarante minutes, ont été menés en petits groupes ou individuellement sur la base d’une méthodologie scientifique de conduite d’entretien et d’analyse des retranscriptions. La trame du guide exploratoire est constituée de questions ouvertes et de relances non exhaustives, qui visent à approfondir les réponses données.
Il s’agissait d’analyser les récurrences dans les parcours en rupture, d’en comprendre les ressorts et d’en faire ressortir l’origine afin d’enrichir notre réflexion commune pour tenter de pallier la grande fragilité scolaire par des dispositifs ciblés bien en amont de la rupture.
Mots-clés : témoignages, décrochage scolaire, parcours scolaires, illettrisme
Préambule : l’école
L’École, dont la représentation est fortement ancrée dans l’inconscient collectif, constitue pour tous un moment essentiel du parcours de vie et d’un devenir dans une société complexe. Les jeunes en rupture que nous avons rencontrés ne font pas exception : globalement, ils n’expriment pas d’amertume vis-à-vis de leur scolarité. Ils ont plutôt une réaction positive à l’évocation du mot « école » et en soulignent les aspects joyeux, en particulier de socialisation.
« On apprend des trucs, on s’amusait. La maternelle, juste devant chez moi. J’y allais avec ma mère », « Y’avait de l’énergie dans l’air » (QM)
Les jeunes en soulignent l’importance, l’utilité et témoignent même d’une forme de reconnaissance à l’égard de ceux qui ont su, à un moment de leur vie, les accompagner, en particulier en primaire, moment de l’apprentissage des savoirs fondamentaux :
« Le primaire c’est important pour bien commencer le collège après », « L’école primaire permet d’apprendre à lire, écrire et s’exprimer ; les bases scolaires » (SMV)
S’ils font montre d’une forme de résilience, s’ils n’expriment pas de profond ressentiment lors de leur réaction première, ils font état toutefois de blessures profondes. Leur discours, après de premiers sourires, s’affaisse dans la narration de moments douloureux, présentés avec résignation, comme s’ils étaient inéluctables eu égard à une détermination sociale qu’ils ressentent confusément. Car tous les jeunes qui se sont exprimés évoquent le sentiment d’avoir été mis à l’écart, oubliés, stigmatisés, jugés, catalogués et étiquetés par le système scolaire.
« [J’avais] l’image d’un élève perturbateur. Qu’est-ce que cela vous faisait ? Ça me faisait rien. J’étais exclu par rapport aux profs. Ceux qui se comportaient différemment, ils m’insultaient – y disaient que j’avais pas d’éducation » (ML)
- L’âge d’or de l’école élémentaire
L’école élémentaire constitue une période idéale, ou idéalisée. Les jeunes font une description hagiographique de leur passage à l’école élémentaire, dont ils soulignent qu’elle s’incarne dans un seul interlocuteur, souvent bienveillant («gentil» est le qualificatif récurrent), à l’écoute, inventif, créatif, proposant des activités dynamiques dont ils percevaient le sens. En parallèle de cette période heureuse, ils esquissent un contexte familial serein, à l’image du vécu en classe.
« Au primaire, tout se passait bien, je m’entendais bien avec les profs, c’était la meilleure période, de la joie, de la bonne humeur. », « Le primaire, j’aimais bien, l’ambiance et tout, comment c’était, j’aimais bien aller à l’école » (QM)
« Au primaire, l’enseignant est attentif, il nous connaît bien. C’est toujours la même personne. » (SMV)
L’école élémentaire, néanmoins, n’est pas exempte de certaines ruptures : la première évoquée par certains d’entre eux est celle de l’entrée au CP. D’un mode d’apprentissage ludique et vivant, laissant de la place à la liberté et à l’enfant qu’ils étaient, ils ont le sentiment de passer à une lourdeur et à un carcan. C’est avant tout la contrainte physique de l’immobilisme qui est ressentie comme une brutalité.
« Ils devraient y aller plus doux pour le passage de la grande section au CP, car d’un coup, on ne peut plus bouger, plus parler », « Il y a une fracture entre la maternelle et le primaire » (SMV)
Malgré ce premier choc, l’école élémentaire reste synonyme de joie et d’une forme de bonheur initial : elle apparaît comme capable d’amortir tant les dissensions familiales, que celles liées à la construction individuelle de l’enfant. Elle offre un cadre stable et rassurant, une routine bienfaisante, au sein d’une classe d’âge à peu près homogène et non anxiogène.
Chacun des jeunes dépeint toutefois dans un second temps une ombre au tableau, une fausse note dans cette période enchantée. Si les enseignants sont décrits comme gentils, il y a toujours une exception : « tous gentils sauf un » qui cristallise l’essentiel des souvenirs douloureux. La parole ne tarit pas sur cette exception et les détails affluent, faisant montre d’un souvenir intact et très précis. Les jeunes reviennent alors longuement sur ce qui ne constitue finalement qu’une très petite part du vécu en primaire. Sont perceptibles déjà dans ces récits les facteurs qui se révèleront déclencheurs par la suite du rejet du système scolaire : manque de douceur (cris), arbitraire, agressivité, punitions, injustice, sévérité accrue, contrainte corporelle (rester assis sans bouger), comportement instable, d’humeur changeante, versatile, insécurisante.
« Il y avait Mme Z., que personne n’aimait. Quand il y avait quelque chose, elle se mettait à crier », « Ils étaient tous bien, sauf un », « Les profs étaient très gentils. Sauf celui du CM1. Je me souviendrai toute ma vie de celui-là. » (ML)
La disproportion de ce souvenir négatif interpelle. Il génère une parole prolixe, comme si ce souvenir constituait les prémices de ce qui allait advenir de la relation à l’école.
La fausse-note ne semble pas néanmoins obérer la qualité de l’ensemble symphonique du souvenir. La présence d’un seul et même interlocuteur (le/la professeur.e des écoles) est donc en mesure de compenser les éventuelles tensions. Elle rassure et sécurise, crée un environnement suffisamment serein dans son ensemble pour laisser une image apaisée dans le souvenir.
Au-delà de l’atmosphère rassurante, c’est également la légèreté, l’insouciance et la souplesse des contenus qui sont également idéalisées : le chant, par exemple, créant une ambiance joyeuse et une communauté, les activités artistiques, la découverte du monde et, surtout, les activités sportives et de motricité, véritable bouffée d’oxygène qui leur manquera ensuite au collège. Les jeunes évoquent le sens qu’ils perçoivent à ces activités, qui accompagnent la construction de savoirs et de compétences, notamment en lecture et en écriture, apprentissages qu’ils qualifient d’essentiels.
« Quand le prof il mettait de la musique et qu’il fallait chanter.» (QM)
« En primaire, on faisait des balles aux prisonniers, de la gym, du basket, du baseball, on touchait à tout. On faisait différentes activités.» (SMV)
L’impression ressentie et décrite par les jeunes d’être à cette époque encore de ceux qui participent à la vie de l’école et de ceux qui y réussissent est frappante. L’adjectif qualificatif «normal» est récurrent, et renvoie à une manière d’exprimer un sentiment de cohésion avec le groupe. Les amitiés sont soulignées, qui sont toutefois toujours décrites comme perdues par la suite.
La relation à la famille à cette période est toujours idéalisée. La présence de la famille est évoquée comme une relation harmonieuse avec un monde qui gravite autour de l’épicentre scolaire. Les relances mettent pourtant au jour que les enfants allaient souvent seuls à l’école. Il est possible que la vision hagiographique de ce moment de leur vie s’assortisse d’images de moments familiaux idéalisés, héritées d’une culture collective et véhiculée via leur socialisation jusqu’à leur mémoire où elles se sont figées, indépendamment de la réalité vécue.
Nous renonçons toutefois au cours de nos entretiens à approfondir la place de la famille, en particulier avec les jeunes détenus, pour qui ce sujet est souvent complexe et douloureux. Nous ne disposons pas d’éléments tangibles pour étayer l’hypothèse d’une relation idéalisée avec le milieu familial à cette époque, hypothèse qui pourra faire l’objet d’une étude ciblée, augmentée d’un regard scientifique étayé en matière de sociologie et de psychologie de l’enfant.
- La cassure du collège
Tous les jeunes que nous avons rencontrés évoquent avec leurs mots une rupture sans appel et d’une grande brutalité lors de leur entrée au collège. Si ce cheminement vers l’autonomie, ce passage vers davantage de responsabilisation est un choc pour tous les enfants, si la sortie du monde de l’insouciance et de l’enfance peut constituer un moment douloureux, si la confrontation avec un monde complexe, peuplé d’adolescents plus âgés et souvent hostiles, ainsi que d’adultes aux fonctions diverses, difficilement identifiables et souvent répressives, est une étape éprouvante dans le cheminement de l’enfant en devenir, les contextes familiaux les plus favorisés sont en capacité de l’accompagner et de l’amortir dans toutes ses conséquences. Les enfants aux profils fragiles ou issus de milieux plus éloignés du monde scolaire et de la réussite, eux, doivent vivre, ou plutôt affronter seuls ce moment charnière de rupture.
« C’était une ambiance, je sais pas Madame, une ambiance froide. […] Y’en avait qui regardaient mal, ils lançaient des regards sombres. Des troisièmes et tout, ils lançaient des regards sombres. Les troisièmes en récréation, ça regardait mal, ça lançait des regards sombres. » (QM)
Le monde du collège est ressenti par eux comme un monde hostile, dans lequel les pairs incarnent un danger potentiel et les adultes un univers autoritaire, systémiquement punitif. Ils comprennent mal le cadre, en cernent mal les contours et l’acceptent difficilement. La bienveillance, la douceur et l’accompagnement incarnés jusqu’alors dans la personne d’un seul enseignant, deviennent diffus jusqu’à ne plus être perceptibles.
Tous les jeunes que nous avons rencontrés soulignent unanimement dans les entretiens comme autant de souvenirs douloureux :
- la taille de l’établissement, la multiplicité des interlocuteurs et le caractère imprédictible de leurs demandes ;
- le rythme nouveau, la fatigue, l’immobilisme en classe, les enseignements trop statiques, le manque d’activités physiques ;
- les réactions souvent déconcertantes ou imprévisibles des professeurs, le manque d’harmonie des consignes et des pratiques dans l’équipe pédagogique. Le manque de «respect», l’arbitraire des sanctions, la violence de la voix ;
- l’injustice ;
- la présence et l’hostilité des plus grands (qui «jettent des regards sombres»), la multiplication des interlocuteurs, la perte des amis d’enfance et, plus généralement, de la stabilité ;
- la solitude, l’isolement, la violence, l’agressivité ;
- l’hétérogénéité des publics et le sentiment de l’inquiétante familiarité (das Unheimliche : l’autre, si semblable et pourtant différent, qui me rejette) ;
- la stigmatisation : le sentiment d’exclusion, de ne pas partager les codes des autres, d’être différent ;
- les propos blessants des enseignants, l’étiquetage implacable et irrévocable, (décrocheur, absentéiste, perturbateur, rétif, agressif, ingérable, …) auquel on finit par se résigner ou se conformer, en adaptant son comportement à ce que l’on est censé être.
Nous avons choisi d’approfondir notre analyse en l’articulant dans un premier temps autour du pivot central qu’est l’autre, dans la perception que ces jeunes ont pu en avoir lors de leur entrée au collège, afin de mettre en exergue combien l’examen de cette relation à autrui, dont ces jeunes perçoivent avant tout les aspects négatifs, est essentielle pour appréhender la rupture.
2.1. Autrui
Les jeunes évoquent un sentiment profond et commun à tous de rejet par les autres, dont ils se sentent différents et dont le regard les blesse. Que ce soit dans la transmission des contenus (dont ils se disent d’emblée éloignés) ou dans la communauté, ces jeunes se sentent fondamentalement rejetés, exécrés. La perception qu’ils ont de l’environnement immédiat du collège et des communautés qui le constituent, fait d’eux des parias. Ils dénoncent alors de manière récurrente le sentiment d’être différent, de ne pas correspondre aux standards visibles, de ne pas faire partie d’un monde fondé sur des codes qui leur sont étrangers.
Le premier rejet est finalement celui des pairs, eu égard à la différence sociale qu’ils incarnent, que cette incarnation soit réelle ou dans la représentation de ces jeunes, issus souvent de milieux fragiles et défavorisés. Le sentiment d’être différent procède de nombreux éléments, qui n’avaient pas été auparavant ressentis par ces jeunes avec autant d’acuité et qui sont décrits avec précision dans les entretiens. Les jeunes évoquent un sentiment diffus qui les met en marge du groupe. Ce sont les autres, tous solidaires dans une communauté dont les codes ne sont pas clairement identifiés (qu’il s’agisse de codes de classe sociale ou de groupe communautaire), qui excluent celui qui est différent d’eux.
Ce sentiment est perçu comme une forme de mépris de groupe ou de classe, considéré par certains comme une forme de ségrégation (voire de racisme) qui les touche eux et eux seuls, éventuellement avec un ami proche et complice dans la situation d’exclusion :
« J’aurais dû rester à l’école. Mais le regard des gens, c’était pesant, c’est pas un truc positif», « Personne ne me parlait. Ils se parlaient entre eux. En promenade j’étais à l’écart. L’ambiance, là-bas, j’ai pas aimé. Les gens, comme ils se comportaient, des bagarres, c’était bizarre.», « C’était tendu entre les élèves et moi et les profs. Ils avaient jamais vu un arabe. Y’avait des russes, des chinois, des trucs comme ça. […] Je suis resté un mois. je suis direct parti » (QM)
« En plus, au collège c’est mélangé, les élèves arrivent de milieux différents », « On m’a dit que j’étais un cas-soc » (SMV)
« Ceux qui se comportaient différemment, ils m’insultaient – y disaient que j’avais pas d’éducation » (ML)
Rejetés par leurs pairs dans leur particularité, leur identité et leur individualité, ils ont le sentiment que la communauté éducative les affuble d’une étiquette, sur laquelle tout le monde s’accorde et à laquelle ils finissent par s’identifier, dans une forme de résignation et d’appropriation identitaire, et avec les conséquences de laquelle ils finissent par se fondre. «On me dit que je suis un perturbateur, donc je suis et serai un perturbateur» :
« Les profs et les pions cherchaient à me faire punir. C’est ce qu’on attendait de moi», «on met des étiquettes sur les élèves » (SMV)
« Je suis un « perturbateur » [gestuelle mettant des guillemets]. Alors je me suis dit qu’ils vont pas me redire après que je suis bon élève, alors je me suis dit : je suis un perturbateur, si vous le dites. » (QM)
« J’avais l’image d’un élève perturbateur », «On m’accusait d’un crime que je commettais pas. Alors je me suis dit, autant le faire. » (ML)
À un second niveau, le sentiment de rejet se concrétise dans l’attitude des enseignants, vécue comme jugeante ou sans la nécessité de s’intéresser davantage à eux. Au mieux, ils se sentent ignorés, au pire agressés. Ils vivent comme un second rejet ce manque d’attention, d’écoute et d’accompagnement, ainsi que la présence des chouchous qui sont meilleurs qu’eux. Ils dénoncent un opprobre des équipes pédagogiques focalisé sur eux.
Ce manque d’attention vécu se lit d’abord au-travers du rythme qu’ils ont l’impression de devoir subir, sans égard pour leur propre processus d’appropriation des contenus :
« Alors qu’en primaire les enseignants prennent le temps, au collège il faut aller très vite », « Au collège, il faut aller vite, les profs changent tout le temps et ne nous connaissent pas », « Au collège, il faut toujours faire vite, copier », « Ils avançaient vite dans le programme […] ils laissaient ceux qui étaient en train de décrocher » (SMV)
« Des fois, ils parlent vite et je comprends pas. Et quand je leur demande, ils me disent : fallait écouter », « Au début [le collège], j’aimais bien, mais tu devais changer de cours, y’avait plusieurs profs » (QM)
Unanimement, ces jeunes se trouvent tout au long de leur scolarité dans une forme de relation à l’adulte qui est intensément affective. La défiance, souvent critique, qu’ils manifestent à l’égard des codes et du cadre les place dans une relation intuitive à l’autre. La conclusion qui s’impose à eux est sans appel : si les professeurs les rejettent, c’est parce qu’ils « ne les aiment pas ».
« La directrice ne m’aimait pas, elle me virait toujours de cours sans raison », « Je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvé dans les élèves qu’elle n’aimait pas » (SMV)
« SVT et tout ça, je l’ai pas oublié, lui. Lui, c’était la misère, il m’aimait pas, ça se voyait. Il avait les nerfs. [Spécialement avec vous ?] Parce que j’allais pas à ses cours. Les fois où j’y suis allé, il faisait sa grosse voix, là » (QM)
Le rejet par les enseignants se trouve augmenté d’une charge émotionnelle particulière, dans la mesure où échoit aux professeurs du fait de leur fonction et à la différence de leurs pairs élèves, la charge et le devoir de s’occuper d’eux. Les jeunes s’insurgent avec virulence contre l’indifférence et la négligence des enseignants qui ne «font pas leur métier» (jugement souvent sévère et peu nuancé des «mauvais profs»). Ils dénoncent des enseignants qui les ignorent, qui les délaissent, ceux qui ignorent leurs besoins particuliers, d’attention, d’accompagnement, d’explicitation, de clarification, d’estime et de valorisation. Lorsque le rejet ressenti vient d’un enseignant, il blesse, il mine le fondement sur lequel se construit le devenir scolaire. Lorsqu’il vient d’un enseignant, le rejet s’apparente au mépris.
« Des gens qui s’en foutent de nous. Il y en a beaucoup. Ceux qui font ça pour l’argent », « ils me calculaient pas trop. Ils ont vu que je faisais de la merde partout, que j’écrivais pas. Quand ils me posaient des questions, moi, je savais pas», «Un autre prof, lui, il s’en foutait. Il mettait son affiche, là, puis il restait derrière son ordi » (QM)
« Mais les profs, il s’en foutaient, ils font leur cours et ils rentrent chez eux », « Au collège ils s’en foutent, ils prennent leur paye, ils veulent finir le programme » (SMV)
A contrario, les bons professeurs sont ceux qui se sont intéressés particulièrement à eux, ceux qui ont fait preuve de douceur, ceux qui les ont valorisés, accompagnés et écoutés.
« Des fois les profs, c’étaient des bons, ils aidaient. […]. Le prof qui aide, Madame, c’est rare.», « Y’avait un prof, un chinois, je sais plus de quoi, il mettait de la joie», «En sixième, musique, c’était bien. Le prof, c’était un bon, il parlait bien. Il rigolait, il faisait des petites blagues », « C’était une bonne prof, parce qu’elle venait vers moi, qu’elle avait pas trop de chouchous. J’avais besoin de ça et elle m’expliquait bien, elle faisait bien son travail. Avec elle, je suivais bien, je l’aimais bien. » (QM)
« J’ai eu un prof qui me prenait de 13h à 13h30, c’était bien » (SMV)
Si tous ces jeunes ont nécessairement pu bénéficier à un stade de leur parcours de moments d’attention et d’accompagnement, leur mémoire émotionnelle n’a retenu, dans une disproportion de la part accordée au négatif, que ce qui n’a pas fonctionné, ce qui les a agressés, ce qui leur a fait violence et les a exclus.
C’est à cette forme d’agression et de violence qu’ils ont eux-mêmes répondu par la violence, dans un engrenage qu’il est indispensable de décrypter, afin de mettre au jour les mécanismes qui y conduisent.
La violence est omniprésente dans les parcours en rupture des jeunes rencontrés, en particulier en milieu carcéral. Elle apparaît comme la seule réponse à la sollicitation d’autrui.
La violence lors de l’entrée au collège est vécue comme un choc, au sortir de la «bulle» du primaire, à l’intérieur de laquelle une forme de douceur semblait préservée. Lorsque l’environnement de l’enfant est difficilement en mesure d’accompagner ce choc, il peut avoir des conséquences douloureuses et délétères sur le parcours du jeune collégien. Dans la cour, c’est la «loi du plus fort» qui règne. Et les plus forts, ce sont soit les plus agressifs, soit, comme souvent, les plus grands.
« Au collège, il y avait trop de petits mélangés tout le temps aux grands et ça partait tout le temps en vrille. Les troisièmes c’est des ados alors que les sixièmes sont encore enfantins », « En sixième on se fait regarder par les grands comme des bébés si on joue aux jeux du primaire. Donc on arrête et on fait plus rien en récré », « Au collège, c’était pas du tout pareil qu’en primaire, il y avait des grosses bastons » (SMV)
« Je suis allé au collège à M. et je me suis battu. Je suis arrivé, on a voulu me tester, je ne me suis pas laissé faire ». (QM)
« En vrai, je me suis battu presque tous les ans, avec des élèves » (ML)
Mais c’est la violence institutionnelle qui, même si elle ne se manifeste pas souvent et pourrait être compensée par l’attention qui leur est prodiguée, est ressentie comme la plus brutale. C’est elle qui laisse d’irréparables fissures dans l’estime de soi et dans la consolidation d’une personnalité en devenir. La parole de l’adulte, pour un enfant, est une parole à laquelle on accorde un immense crédit. Les professeurs, par des mots parfois pour eux anodins et sans conséquences, parce que ces mots ont dans la perception des enfants et leur contexte présent une implication tout autre, par leur attitude et par d’éventuelles sanctions, stigmatisent ces jeunes déjà fragiles, les exposent au regard de l’autre (et à son jugement) et les blessent durablement.
« Quand on est petit, même pour un rien, ça vous touche », « Toi, tu vas pas réussir, y me disaient, les profs » (QM)
Dans le récit que font ces jeunes des situations de violence, reflet de la perception profonde qu’ils en ont, l’agression vient toujours de l’autre : c’est l’autre qui «embrouille» et la violence qui sera la leur est toujours selon eux en réaction à cette agression.
La réponse à ces agressions vécues comme une fatalité est donc fatalement toujours violente : dans les mots ou dans les gestes. A chaque fois, la réaction violente est présentée comme inéluctable et évoquée avec résignation.
Elle est également ressentie et décrite comme en miroir à celle de l’autre : des insultes en réponse aux insultes, la colère en réaction à la colère, une disproportion en réponse à une première disproportion, la brutalité en réaction à la brutalité.
« Mais s’il me respecte pas, je le respecte pas. Et ça peut aller jusqu’à des coups », « En sixième, ça allait, mais en cinquième, j’ai commencé à avoir des embrouilles avec les profs. Les professeurs, ils me provoquaient. Je me suis embrouillé avec un, ils m’ont renvoyé deux jours», « Les profs, j’avais des embrouilles avec les profs. Dès que je disais un truc, ils cherchaient un petit truc pour me rendre fou », « Un jour, c’est parti en insultes. On s’est insultés, il m’a insulté. On s’est tapés » (QM)
« Je me suis battu une fois avec un prof – le prof de SVT. J’étais derrière, un élève m’a insulté, le prof a vu que ma bêtise, pas la bêtise de l’autre. C’est parti sur des provocations, une poubelle, je l’ai jetée » (ML)
On constate des récurrences dans les situations qui déclenchent une réponse violente de la part de ces jeunes. Le simple fait qu’un adulte hausse la voix, crie de manière ciblée sur l’individu (ou sur un autre qui lui est proche), peut être un facteur de stress suffisant pour provoquer une réaction violente immédiate :
« Chépa, ils savent être que tendus, ils sont au calme et ils vous crient dessus», «Je me suis embrouillé avec la chef du truc, elle me faisait la morale, elle me criait dessus, elle me disait, tu fais le bordel partout, c’est pas possible » (QM)
« Il me hurlait dessus devant tout le monde En quatrième et troisième, je mettais plus le souk, mais il continuait à me hurler dessus. » (ML)
« Dès le collège, on s’est mis à me crier dessus. Je ne supporte pas qu’on me crie dessus », « Au collège, les profs parlent mal, ils élèvent la voix et moi j’aimais pas. Ça me faisait monter en pression » (SMV)
Notion clé, d’interprétation très subjective, le respect, et en particulier son manque, est omniprésent dans les récits que font les jeunes de leur parcours et de la rupture. La sensibilité à l’idée qu’ils se font du respect qui leur est dû est difficile à appréhender, tant ils comprennent sous ce concept un foisonnement de ressentis, de frustrations, d’agressions sourdes, de connotations, de langages non verbaux, de codes, de non-dits, d’allusions, de tensions sous-jacentes et de souvenirs confus.
Il est certain que l’exposition à la critique insultante devant les autres est un facteur objectivable qui provoque la violence, tant il déclenche de la colère par l’injustice ressentie et la fragilisation (l’autre étant déjà source d’insécurité et de doutes).
« Il me disait que j’avais une écriture de cochon, j’aurais aimé que le prof il aille pas montrer mon écriture à un autre prof pour se moquer de moi. Même si j’avais une écriture de cochon, qu’on le voie pas comme ça. C’est pas très glorieux, mais ça donnait plus envie de faire quelque chose. » (ML)
« Mais s’il me respecte pas, je le respecte pas. Et ça peut aller jusqu’à des coups. il m’a dit, espèce de guignol. Je me suis embrouillé avec lui, il m’a renvoyé de cours. C’est un fou, lui. Y me dit ça et je lui ai dit, c’est toi le guignol, et j’ai jeté la chaise», «et puis le prof, il a dit à un ami, t’es petit comme une mouche. On était dégoûtés parce qu’il avait dit ça devant les autres » (QM)
Part du manque de respect, mais sentiment plus complexe et plus vaste, ressenti dans de multiples situations du contexte scolaire, l’injustice est à l’origine tant d’un renforcement du sentiment d’exclusion et du rejet, qu’elle cristallise, que du surgissement de la violence.
L’injustice est double : elle relève à la fois de l’arbitraire, du jugement sans nuance et de la disproportion de la sanction, ainsi que du manque d’écoute et de crédibilité accordée à la parole de celui qui se défend. La culpabilité n’est pas décisive dans ce contexte. Les jeunes concèdent volontiers que leur attitude a pu générer auprès de la communauté éducative de la crispation, voire du mécontentement. («Le prof, il devait craquer, il avait que des phénomènes», QM). Toutefois, c’est l’aspect systémique de la sanction et du reproche, qui touche toujours les mêmes (du moins ceux qui se ressemblent ou présentent des attributs semblables), de l’exposition à l’opprobre et de l’acharnement qui les blesse et qui provoque leur colère.
« J’ai eu un prof qui me mettait dehors dès que j’ouvrais la bouche. Au début ça allait et d’un seul coup ça s’est fait comme ça. Je n’ai jamais su pourquoi, si j’avais fait quelque chose… C’est bizarre car au début, il était sympa » (SMV)
L’exposition publique de leurs fragilités au regard forcément stigmatisant et rejetant de l’autre renforce l’impression d’exclusion et d’isolement. Elle est unanimement vécue comme un traumatisme dont il est difficile de se relever. L’étiquetage se consolide, il est partagé par l’ensemble des acteurs du collège jusqu’à devenir un carcan dont on ne peut s’extraire. L’exclusion physique et souvent définitive du collège, qui fera suite à un acte grave de violence, apparaît alors comme la seule issue, ainsi que comme la possibilité d’un recommencement, dont l’efficacité toutefois s’avère rarement, tant convergent à nouveau dans l’établissement suivant les mêmes contextes, les mêmes ressorts et les mêmes rejets.
L’injustice, c’est surtout le sentiment d’une fatalité. Comme si leur parole n’avait dans ce cadre aucune valeur, aucun poids, comme si leur existence n’était qu’un jeu d’ombres, une scène sur laquelle se jouerait une comédie humaine où ils tiendraient le rôle de l’exclu. La part du déterminisme social, qu’il soit ou non conscient chez ces jeunes, est immense et les force à endosser le rôle auquel leur environnement et autrui les destinent :
[Relance sur les conseils de discipline, avant exclusion définitive] « J’y allais pas. Je savais pas à quoi ça servait d’y aller. Quand on arrive là-bas, y z’ont déjà leur décision dans la tête. Je savais qu’ils m’écouteraient pas » (QM)
« Au lycée, je me suis fait virer parce que j’avais pas fait un devoir d’anglais. Tout le monde avait le droit de le rattraper, mais pas moi » (ML)
L’injustice est d’autant plus à l’origine du renforcement d’un sentiment de rejet et d’exclusion que certains semblent bénéficier a contrario d’un traitement de faveur. « Les enseignants ont tous leurs chouchous ». Ce n’est pas à ces derniers qu’on tient rigueur de ces privilèges, mais bien à l’institution qui les accepte, voire les encourage. La présence de chouchous, souvent plus conformes qu’eux aux standards sociétaux, conforte leur sentiment d’être différents et de ne pas faire partie de ce monde scolaire, qui les rejette et ne tardera pas à les exclure :
« Les profs ont toujours un élève qu’ils préfèrent, un chouchou. Parfois parce que les parents avaient beaucoup de sous ou connaissaient le prof », « Au collège, à la différence du primaire, les profs ont des chouchous. Ils ne sont pas équitables avec tous les élèves » (SMV)
« Pas les chouchous, pour eux, ça se passait bien. Le principal, la CPE, ils en avaient tous. » (ML)
2.2. Rupture systémique
Si autrui cristallise le rejet, les jeunes sont unanimes aussi pour ce qui relève du système, contenant en lui-même des éléments intrinsèques qui concourent à la rupture.
- La lassitude, l’immobilisme, la passivité et l’ennui
Les récits que font les jeunes décrocheurs de leur passé scolaire laissent entrevoir l’ennui éprouvé tout au long des journées en classe, où l’immobilisme et la passivité accroissaient un sentiment de vacuité.
« On s’endort », « C’est répétitif » (SMV), « De l’ennui », « je m’ennuie et y’a rien à faire, y’a pas d’ambiance » (ML)
Avec le recul, certains jeunes sont capables de voir dans l’ennui la source de leur agitation, expression d’une forme de mal-être : «On met le bazar parce qu’on s’ennuie» (SMV)
Ils abordent leurs difficultés individuelles à demeurer en position d’élèves assis dans une classe, cette dernière étant vécue comme une contrainte physique confinant à la torture :
« On ne peut pas rester assis tout le temps sur sa chaise, ce n’est pas possible », « Une heure assis, c’est trop long. […] On subit les cours», «Moi j’aime pas en mode être assis pendant des heures et écouter » (SMV)
Cet immobilisme est ressenti comme une brutalité, a fortiori lors de chaque passage d’un contexte scolaire à l’autre. La contrainte des corps est une violence imposée aux enfants, sans que ceux-ci puissent en saisir le sens, mais qu’ils subissent comme une réalité institutionnelle non négociable, peu propice à encourager leur adhésion.
Les jeunes soulignent le décalage profond entre le contenu des enseignements et ce qui constitue pour eux la «vraie vie» : dans leur présent, mais également dans ce qu’ils projettent de leur futur. Les enseignements généraux leur semblent déconnectés des besoins criants qui sont les leurs dans l’appréhension de leur vie et de leur avenir. Ce décalage patent entre les enseignements et leur réalité provoque pour une grande part leur jugement irrévocable :
« Le collège c’est inutile, ça m’apprend rien pour le métier plus tard » (SMV)
Leur éloignement de la sphère scolaire ne signifie en rien qu’ils ne sont pas au cœur de leur temps, de leur époque et de ses enjeux. Parce qu’ils en connaissent la portée, parce qu’ils sont conscients des obstacles qui se présenteront à eux dans leur évolution, ils peinent à se reconnaître dans la démarche universaliste et humaniste propre à l’académisme. L’absence de lien avec le «concret» de leur réalité accroît leur sentiment de ne pas faire partie du monde de ceux qui y trouvent un intérêt.
« Collège et tout, c’est ennuyeux, c’était pas fait pour moi. Tu dois apprendre des trucs que tu dois oublier dans un mois, ça sert à rien que j’apprenne ça. J’aurais aimé un cours utile. Tu veux faire quoi plus tard, on se décide et on apprend des compétences par rapport à ce métier», «En mode ça sert à rien de perdre son temps à apprendre des trucs qui servent à rien. Mon employeur va pas me demander tu as lu quel livre, tu sais conjuguer tel verbe. Un livre de 50 pages avec que des mots, ça nous intéresse pas, c’est que la prof que ça intéresse. Je veux bien lire un livre qui va me donner des conseils dans la vie » (ML)
« Je voudrais juste travailler à mes 18 ans, je voulais un travail, à l’usine, ça sert à rien qu’on me forme » (QM)
« Ce qu’on apprend ne sert à rien », « Les SVT, ça sert à rien, sauf la partie sur la sexualité », « En maths, on a parlé des x, des y. On nous parle de trop de choses qui servent à rien. Le théorème de Thalès, ça sert à rien… si je peux esquiver les maths… » (SMV)
Les jeunes racontent avec une forme de résignation, de fatalisme et d’indifférence, les exclusions successives qu’ils ont vécues. Ils énumèrent les différents collèges par lesquels ils sont passés comme s’il s’agissait d’une grande banalité. Nombre de collèges entre la cinquième et la troisième : « environ 7-8 – […]. J’avais juste mal à la tête, et fallait me lever tôt. » (QM).
Le sentiment d’une forme de déterminisme pèse sur l’analyse qu’ils font de leurs multiples exclusions. Au cycle 4, l’exclusion progressive du système apparaît comme inéluctable. Le conseil de discipline est une instance qui acte un état de fait. Tout y serait joué d’avance : le monde des adultes, le monde de l’institution scolaire aurait déjà pris la décision. L’organisation d’un conseil ne serait plus qu’un simulacre, destiné à donner une forme procédurale à ce qui a été tranché bien en amont.
« J’y allais pas. Je savais [au sens de : ne voyais] pas à quoi ça servait d’y aller. » [Relance : une chance de vous défendre?] « Quand on arrive là-bas, y z’ont déjà leur décision dans la tête. Je savais qu’ils m’écouteraient pas » (QM)
- L’orientation : l’impossible soutien des familles
Le soutien dont bénéficient les jeunes de milieux sociaux plus proches de la réalité académique et du système scolaire (devoirs maison, préparation à des échéances symboliques et/ou décisives) est présenté comme étranger au quotidien scolaire des jeunes en rupture. Pour ces jeunes, ce qui échoit aux familles et qui est accompagné sans difficulté constitue un obstacle supplémentaire dans leur scolarité et les stigmatise toujours davantage :
« Ma mère, elle est pire que moi. Elle peut pas m’aider pour les devoirs. Les profs devraient donner des devoirs que l’élève est apte à faire. Ou bien les faire à l’école. Ou bien donner peu de devoirs », « Le pire c’est les devoirs à la maison notés alors que nos parents ne peuvent pas nous aider » (SMV)
Le moment de l’orientation, en particulier en fin de troisième, cristallise tout le désarroi des jeunes et des familles qui se retrouvent face à la complexité d’un système dont ils soulignent le caractère impénétrable et dont ils se sentent une fois de plus exclus. Les méandres de l’orientation constituent donc un obstacle insurmontable et mènent à une orientation subie, peu propice à les aider à construire un projet solide.
« Jusqu’au lycée, en troisième, je savais pas quoi faire. Les profs m’ont emmené au CIO, avec l’ONISEP et tout, même après ces rendez-vous je savais pas quoi mettre pour mes vœux. Je suis retourné voir le conseiller, puis j’ai mis des vœux au pif. [Quel âge aviez-vous?] J’avais 15 ans et pas d’orientation, alors ils m’ont mis au lycée M. [une classe passerelle que le jeune n’arrive pas à nommer]. Puis ils m’avaient parlé du CAP peinture au C. Et je savais pas quoi faire après ça. Et après 16 ans, tu peux arrêter l’école. [Rectification – obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans]. On a essayé, avec des listes avec plusieurs métiers, et tout. Je savais pas quoi faire.»
[votre famille pour cette réflexion?] « Non, la famille, ils ont pas fait attention à l’école. Et ma mère, elle parle pas français » (ML)
« Mes parents, y savaient pas », (QM)
Les jeunes décrocheurs sont sollicités par leur établissement d’origine et par le système. Mais à un moment donné, les relances s’arrêtent et ces jeunes tombent dans l’oubli. Après un premier soulagement, voire de la satisfaction, ils se sentent abandonnés. La situation dans laquelle ils se trouvent de facto vient conforter le déterminisme initial dont ils avaient conscience. Le système les oublie, car ils n’en ont jamais réellement fait partie.
« Non, j’ai abandonné. Ils nous laissent tomber quand y voient qu’on n’est pas capables de faire des choses », «J’ai fait trois demandes, mais ils m’ont refusé. Trois établissements à C… Au début, j’étais content, puis j’étais moins content. Je voyais des gens acceptés, j’étais le seul à pas être accepté. Et Madame, si l’école c’est obligatoire, pourquoi y m’ont pas mis ? Pourquoi alors y m’ont pas affecté ? » (QM)
- En guise de conclusion
Selon les jeunes, l’École gagnerait à évoluer en donnant davantage de sens aux apprentissages, en garantissant des relations scolaires bienveillantes entre élèves, mais aussi entre élèves et adultes, en donnant une place plus importante à l’activité physique quotidienne, en abandonnant l’approche par les notes et la mise en concurrence visible entre élèves.
Il est frappant de constater que les paroles des jeunes décrocheurs se recoupent avec les résultats de la recherche et les courants de réflexion menés dans le domaine de la formation et des sciences de l’éducation. Ces propos sans concession sur l’École renforcent l’importance de la prévention, qui dépasse le repérage de signaux de décrochage et la réponse par des actions ciblées sur l’individu et non sur le système.
Les professionnels de l’éducation, à l’aune des propos recueillis dans cet article, pourront questionner les pratiques pédagogiques courantes et les interactions qui concourent à l’accrochage ou au contraire au décrochage. Il n’est pas question de stigmatiser une sous-population d’élèves mais au contraire de concevoir une École réellement inclusive. Le regard que tout pédagogue porte sur l’élève est dans ce contexte plus que jamais fondamental ; il renvoie à ce soutien indéfectible et sans condition auquel tout élève a droit.[1]
Cécile-Eugénie CLOT
IA-IPR – Académie Strasbourg
Natacha FERLAC
Professeure des écoles spécialisée – Formatrice université de La Rochelle
Fabien MARMONIER-LECHAT
Inspecteur de l’Éducation nationale
[1] : Les auteurs remercient Frédérique Weixler pour sa précieuse contribution à la rédaction de ce texte.
Télécharger cet article au format pdf