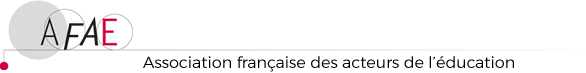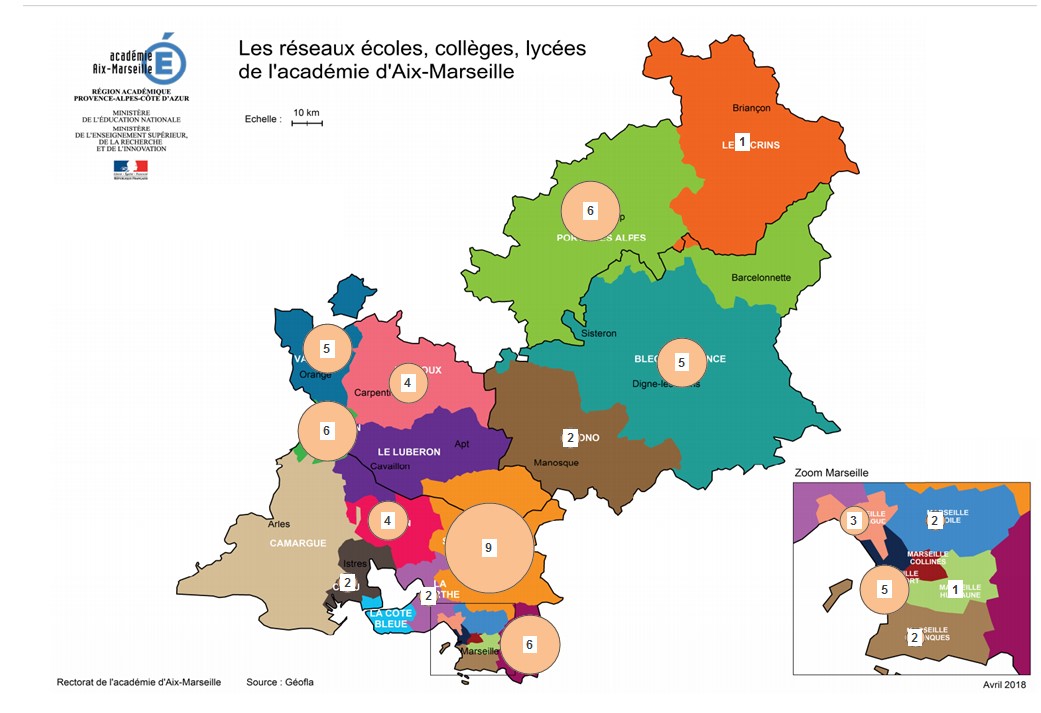La crise ? Et après ?
Réflexions à partir du texte d’Alain Bouvier, adressé aux enseignants et aux CPE, “#COVID19 : il faut préparer le monde pédagogique post crise“
par Alain PICQUENOT
»»» La totalité des chroniques d’Alain Bouvier, intitulées “Questions taboues sur le système éducatif français”, sont à (re)découvrir sur le site Résonances.
Alain Bouvier a publié Adresse aux enseignants et aux CPE, il faut préparer le monde pédagogique d’après la crise le 27 mars 2020, soit 10 jours après le début du confinement. Ce document est le premier état des lieux, déjà synthétique, du système éducatif dans une situation extraordinaire : les écoles et les établissements sont fermés, les élèves et les enseignants sont confinés chez eux et l’École qui se voulait sanctuaire se déplace « à la maison », celle de l’élève, celle du professeur. Il saisit un moment où, les premières difficultés techniques étant (presque) passées, des modes de fonctionnement et de vie se mettent en place et s’ajustent ; enfin, il est écrit par un parfait connaisseur de notre système, de ses réalités, de ses logiques d’acteurs et de ses enjeux. Il est un appel au débat. Pour toutes ces raisons, il fera date, il doit faire date ! Ce qu’il décrit de l’existant et ce qu’il envisage de la suite, sans donner de préconisation, est très stimulant pour le lecteur, conscient à la fois des tendances lourdes de l’École et des obligations contradictoires dans lesquelles elle est : persévérer dans son être et se transformer. Construit, à partir de l’Adresse, autour d’un nombre limité de thèmes, le présent texte est une contribution aux réflexions et aux échanges qui doivent avoir lieu sur la situation en cours et les perspectives qu’elle dessine. Il s’agit d’esquisses notamment à partir de dialogues avec différents acteurs (qu’ils soient chaleureusement remerciés !), l’auteur ayant essayé d’échapper aux différents pièges de l’exercice, notamment celui de la généralisation abusive ! Notre propos porte sur le seul second degré.
Science, santé, information, citoyenneté
À propos du COVID-19, discours et débats mettent en scène des journalistes, des politiques, des experts habituels mais encore des praticiens (comme les médecins généralistes) et des savants (le Professeur Raoult, très médiatisé, se présente comme scientifique et comme épistémologue).
– Nous observons, pour les uns, devant les micros et les caméras, le plus souvent, avec des exceptions qu’il faut saluer, une incapacité à exprimer un discours scientifique compréhensible, et en même temps, pour les autres, auditeurs et téléspectateurs, l’impossibilité de recevoir un discours pertinent, d’autant plus que l’idée commune est celle d’une science qui sait tout, dure et intangible, donc capable de trancher, de préférence dans l’immédiat, en termes de vérité. Les journalistes qui devraient être les traducteurs ou les pédagogues de la situation n’en sont manifestement pas capables. En ont-ils l’envie ? Faut-il s’étonner de cette absence de « sensibilité scientifique » de la majorité de ces différents professionnels et des français moyens que nous sommes, vu le petit nombre d’heures consacrées aux sciences dans l’enseignement primaire pour la grande majorité des élèves, et compte tenu du peu d’importance que notre société accorde auxdites sciences, via le discours journalistique notamment ? Certains usages des réseaux sociaux et l’absence d’une formation à la question de l’information et de la communication assombrissent encore plus le tableau.
– Dans chaque établissement, existe un Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) où, le plus souvent, la citoyenneté est réduite à la portion congrue, parfois de curieuse façon. Laissons coexister ces deux notions, bien que ce rapprochement puisse paraître curieux. Que le Premier Ministre, puis le Président de la République se soient sentis obligés de nous donner des leçons de lavage de mains suggère que nos sociétés dites avancées ont encore des progrès à faire en termes, tout simplement, d’hygiène (ce que montrent tous les sondages à propos de notre pays).
– Ces exemples montrent également que le politique, d’autres parleront de citoyenneté, est, parfois bien peu de chose. Un journaliste peut donc affirmer, doctement, que « rester chez soi, c’est résister » comme, après les attentats de 2015, prendre un café à une terrasse était devenu un acte de Résistance, avec une majuscule bien sûr. La citoyenneté, dans une démocratie par essence fragile, à un moment où la démocratie à la française apparaît très vulnérable ne mérite-t-elle pas mieux ?
Science, santé, citoyenneté, mais également information et communication, la situation que nous vivons montre des domaines où l’École peut mieux faire, selon l’expression consacrée, dans un souci de prévention, de précaution, d’anticipation et de préparation.
Numérique
Les jeux entre l’École et le hors l’École, entre la Maison et le hors Maison, entre le formel et l’informel (sur lequel Alain Bouvier insiste), mais encore les incontournables relations entre l’enseignant, l’élève dans sa singularité, la classe et les groupes qui la constituent, les rapports au savoir, etc. se cristallisent autour des outils numériques et de l’Internet, au nom de la continuité éducative. Dans l’analyse, nous devons nous méfier du Charybde qui fait d’eux des supports neutres et du Scylla qui les transforme en déterminants de situations à la fois éducatives, pédagogiques et didactiques. Les professeurs peuvent être magistraux ou à l’écoute, du groupe ou de tel élève, ils favorisent ou pas les interactions, les élèves peuvent être passifs ou actifs, en coopération ou en compétition, tous selon leurs maîtrises des moyens à leur disposition, selon leurs habitudes ou en rupture avec elles dans un nouveau contexte. Telle élève très discrète se trouve très impliquée dans une relation individuelle nouvelle avec tel professeur, mais uniquement lui, tel enseignant jugé psychorigide est plein d’empathie dans ses dialogues avec tel élève en difficulté, telle autre, plutôt chahutée en présentiel augmente le nombre d’exercices. Ici, les cours sont plutôt descendants, là c’est une classe inversée virtuelle qui vit… Globalement, la clef appartient d’abord à l’enseignant qui fait selon son approche pédagogique, mais également en fonction de sa maîtrise des outils, ceux qui lui sont fournis ou ceux qu’il se donne. Par ailleurs, le psychanalyste ne manquera pas de souligner que l’image du professeur qui travaille avec des images d’élèves ouvre sur une « autre scène » qui a ses effets spécifiques. Nous proposons donc l’hypothèse de travail suivante. Avec ses inévitables ratés et avec ses bonheurs propres, si nous la regardons à travers le prisme du numérique, la situation d’aujourd’hui nous semble encore très « marquée » par l’hier, le numérique étant un révélateur et, sans doute, un accélérateur pour des sous-groupes d’enseignants et d’élèves outillés, motivés ou remotivés, capables, et sans doute ayant envie, de se libérer du carcan des habitudes et d’être inventifs.
Groupe, espace, temps
Pour nous décentrer encore plus du numérique, pour regarder la même réalité d’un autre point de vue, il nous faut rappeler les attendus de l’enseignement traditionnel ou formel qui est encore dominant en ce début de XXIe siècle. Un groupe dit classe, dans un espace dit, lui aussi, classe, dans un temps donné, c’est-à-dire une heure de… 55 minutes, tels sont les éléments de base.
– Dans l’enseignement à distance que connaissent les élèves et les enseignants aujourd’hui, qu’en est-il du groupe classe ? Dans quelle mesure et à quelles conditions existe-t-il ? La mosaïque avec la juxtaposition des visages ? Ou la succession, ordonnée, dans les deux sens du mot, des visages ? Le professeur et ses graphiques ? Quid des relations licites entre les élèves ? Et des échanges « parallèles » par SMS ? La notion de groupe classe mérite d’autant plus d’attention que la Réforme du Lycée lancée au cours de cette année scolaire 2019-2020 la remet en question.
– Quid de l’espace ? Question qui devient : quid des espaces ? L’élève est dans une situation pédagogique, mais il est d’abord « à la maison », dans son espace familial, voire personnel, sa chambre, qui est parfois considéré comme son domaine privé. Rappelons l’importance dans la vie des adolescents d’aujourd’hui, de ce que l’on appelle « la culture de la chambre » qui est, en partie, un effet-Internet et parfois organisée à partir d’outils de communication.
– Qu’en est-il du temps ? L’enseignant dispose d’un créneau, et qu’en est-il de l’élève si les parents sont en situation de télétravail ou si les autres enfants ont, eux aussi, besoin de l’ordinateur ? Comment le temps du cours est-il organisé ? Ce qui revient à la question : que font, réellement, les élèves ? Quelles sont leurs activités ? Globalement, le temps consacré aux relations individualisées et même personnalisées a fortement augmenté depuis le 17 mars, du professeur vers l’élève et de l’élève vers le professeur. Les cas d’overdose sont même nombreux, des deux côtés !
En résumé, le groupe n’est pas le même, en tout cas, la perception qu’en a chaque acteur est nouvelle. Les murs de la salle de classe n’existent plus, la relation change entre le « professionnel » et le « personnel » pour l’élève comme pour l’enseignant. La notion de temps, elle-même, évolue, d’autant plus que chacun peut adresser, à tout moment, un message à chacun. Tout ceci, en tenant compte du numérique puis à partir du traditionnel classe-espace-temps, pour dire que, actuellement, le groupe traditionnel est moins présent en tant que tel. De leur côté, les relations individuelles du type un enseignant-un élève sont plus fréquentes, à partir du travail personnel et sur le « moral » de l’élève considéré davantage comme une personne. Dans ce jeu d’acteurs, comme le souligne très fortement l’analyse d’Alain Bouvier, les parents ont davantage leur place, nous y reviendrons dans la rubrique qui suit.
Nous faisons l’hypothèse que des évolutions sont possibles, notamment à partir du groupe classe et de sa remise en cause, dans un jeu entre groupe, espace, temps, et numérique. Encore faudra-t-il tenir compte des cinq publics mis en évidence par Alain Bouvier qui peuvent être ou qui sont déjà les victimes du confinement. La prise en compte de l’hétérogénéité, et pas seulement celle des équipements, est plus que jamais à l’ordre du jour. Il en est de même de l’évaluation ou plutôt des types d’évaluation, point faible comme chacun le sait de notre système éducatif, ce que le baccalauréat cru 2020 confirmera à sa façon. De nombreux établissements tiennent et même avancent, notamment parmi les collèges, grâce à une minorité d’enseignants (et de CPE) innovants qui donne une dynamique à l’ensemble. Une des questions de demain sera celle, sans doute, des conditions de mobilisation de cette minorité, et autour de ces thématiques. Nous y ajoutons volontiers celle de l’accompagnement car c’est bien ce qui est en œuvre, aujourd’hui, chez les enseignants, les CPE, les parents et les élèves (entre eux), comme chez d’autres acteurs. Son esprit et l’attitude qu’il implique permettent à chacun d’agir de sa place : le parent n’est pas un professeur, le professeur n’est pas un parent, en dépit de de certaines dérives, déjà. Et, à propos, dans les faits, chez les uns et chez les autres, qu’en est-il du féminin et du masculin ?
Acteurs, reprise
Après la crise, viendra la reprise, sans que l’on sache qu’elle forme elle prendra, une sorte de rentrée bis en fin d’année scolaire peut-être, ou une rentrée en septembre ou plus tard, après une année 2019-2020 sans sortie véritable. A ce moment, allez savoir ? En tout cas, pour que l’expérience actuelle contribue positivement à l’évolution du système éducatif, les réflexions d’Alain Bouvier et les pistes qu’il propose en creux nous semblent incontournables. Dans cette perspective, l’analyse des acteurs l’est également.
– Dans les réussites, les personnels de direction, chefs et adjoints, ont montré une fois de plus qu’ils sont des personnages clefs pour, notamment, impulser, organiser, coordonner, mobiliser, réguler… tout en soutenant tel professeur désemparé, tel parent désorienté, tel élève qui se sent abandonné…
– Les organisations ont besoin d’« encadrement intermédiaire » pour fonctionner. Les professeurs principaux sont des cadres intermédiaires de plus en plus indispensables à l’efficacité des EPLE. Dans les réussites, ils l’ont confirmé, en lien avec les personnels de direction et avec les membres de l’équipe éducative, pour élaborer des synthèses et les communiquer. Ils ont joué leur rôle de représentant de l’équipe auprès des élèves, le Conseiller principal d’éducation apportant sa spécificité professionnelle auprès de certains d’entre eux. Des « PP » ont réussi à réguler leurs collègues emportés par une logique disciplinaire surchargeant les élèves. Nous noterons que, dans les reportages vus, lus et entendus, les professeurs principaux et les CPE ne sont jamais cités.
– Les élèves reprendront avec des vécus divers. Ici, ils ont redécouvert les déjeuners et les jeux en famille tout en ayant leur part d’indépendance pour leur travail et leurs relations amicales, là, ils ont été mis de côté ou plus maltraités qu’à l’ordinaire. Les plus autonomes sont sans doute encore plus autonomes, mais que sont devenus et que vont devenir ceux qui appartiennent aux cinq groupes désignés par Alain Bouvier qui risquent fortement d’être les perdants du confinement ? Comment seront-ils accueillis et pris en charge ? Tout simplement, retrouveront-ils le chemin de l’École ? N’oublions pas que, globalement, les élèves seront heureux de retrouver leur établissement, et, soyons lucides ! d’abord parce qu’ils vont retrouver leurs amis et amies et qu’ils auront beaucoup, beaucoup à se dire, même si WhatsApp a bien fonctionné !
– Les inspecteurs ont leur part dans les réussites. Dans ces cas, leur expertise et leur légitimité disciplinaires et, malgré ce qu’en disent des esprits chagrins, leur connaissance des terrains, a été précieuse aux enseignants pour faciliter leur accès aux ressources, transformer des documents afin de les rendre accessibles dans le cadre de l’enseignement à distance, doser d’une façon nouvelle la part du collectif et celle de l’individuel, faire évoluer des attitudes dans un contexte nouveau. Et ils ont su les encourager !
– Comme le souligne très fortement l’analyse d’Alain Bouvier, des parents ont participé à l’accompagnement scolaire de leurs enfants, beaucoup plus que d’habitude, en étant davantage dans le champ pédagogique, qui plus est, sur une longue durée. « Nous faisons le travail du prof ! » disent-ils. Certains ne manqueront pas de le rappeler, ce qui ne les empêche pas de les considérer comme « des héros » ou « des saints », eux qui « supportent » leur progéniture pendant toute une année scolaire. Des familles, « très éloignées du système scolaire », selon la formule aujourd’hui consacrée, n’ont pas pu aider leurs enfants. Elles ont vu des reportages sur « l’école à la maison » qui se déroulaient chez des CSP++ (en mettant en scène des filles le plus souvent) et d’autres, quelque peu condescendants dans des quartiers dits « populaires ». Souhaitons qu’elles n’en concluent pas que l’École n’est vraiment pas faite pour elles et que l’École fasse preuve de volontarisme pour les retrouver et les accompagner.
Sortir de la crise, reprendre, trouver un chemin entre deux tentations : « revenir à « la normale », comme si de rien n’était » et « rien ne sera plus comme avant »… Dans un contexte anxiogène où l’imprévisible l’emportait sur l’imprévu, dans un monde scolaire construit sur le mode de la répétition (les 36 semaines de l’année scolaire déroulent un même emploi du temps et de l’espace avec les mêmes groupes), dans des unités éducatives, des acteurs ont pris une densité nouvelle et acquis ou confirmé une forme d’autorité, en créant une certaine sérénité et en donnant un cadre de travail aux uns et aux autres. La reprise ne pourra pas se faire sans que leur importance soit reconnue. Cette reconnaissance est une condition nécessaire à la mise en œuvre d’évolutions souhaitables et possibles pour qu’elles s’inscrivent dans le temps. Le pire serait que le découragement suive la mobilisation, mais le lien devra être maintenu ou recréé entre les mobilisés et ceux qui auront subi l’épreuve. Un double défi ! C’est dire que le jour « j » de la rentrée ou de la reprise ne pourra pas être comme les autres, mais nous connaissons la grande capacité d’inertie des bureaucraties et de certains groupes d’acteurs, fussent-ils animés par les meilleures intentions…
Crise
Crise, toujours au singulier, crise comme « crise sanitaire », comme « alerte, coronavirus », il va de soi que nous sommes dans une période de crise, mais au fait, de quoi parlons-nous ? A la fin des années soixante-dix, la « crise du pétrole » qui a sonné la fin des « trente glorieuses » a lancé le terme qui est devenu un maître-mot des discours journalistique et politique. Aujourd’hui, nous ne vivons pas la même crise qu’hier et nous ne la vivons pas de la même façon. La crise était un moment étonnant et violent, précédé d’une avant-crise et suivi d’une après-crise considérée comme un retour « à la normale ». C’est avec cet arrière-plan que s’est développée la notion de projet, très mobilisatrice pour les chefs d’établissements et les enseignants innovants, au début des années 1980. Le livre de Myriam Revault d’Allonnes intitulé La crise sans fin (Le Seuil, Paris, 2012) nous éclaire sur cette crise d’aujourd’hui qui n’est plus ce qu’elle était. Elle écrit : « de changement brusque, de moment paroxystique, la crise est devenue une réalité permanente. Elle est le milieu de notre existence qu’elle a envahie de part en part ». Elle ajoute : « à l’origine moment singulier, situation exceptionnelle, rupture du cours habituel, elle est désormais la norme de notre existence » (p.132). Sans doute faut-il parler, à partir de notre situation actuelle, d’une crise plurielle : crise économique, au demeurant commencée avant que n’apparaisse le COVID-19, crise sociale annoncée par les « Gilets jaunes », etc. Nous renvoyons volontiers à cet ouvrage qui nous éclaire sur une actualité durable et changeante. Il est sous-titré Essai sur l’expérience moderne du temps, la dé-temporalisation étant un des éléments de la définition de la crise. Or, le système éducatif a une relation très spécifique au temps : des adultes ont décidé de passer leur vie professionnelle avec des enfants, les semaines d’une année scolaire se ressemblent, les années scolaires qui se suivent sont construites sur les mêmes principes de l’emploi du temps, autour de la sacro-sainte heure de 55 minutes, l’École de l’ici – maintenant prépare à un ailleurs – plus tard, l’École a son temps propre, plus ralenti que celui, sans cesse accéléré de la société… Nous faisons l’hypothèse que plus la rentrée sera tardive, plus la tendance au retour au « normal » d’avant sera forte. C’est donc, à sa façon, avec ses temporalités propres, que l’École vivra dans la crise et ses propres crises. En tout cas, les analyses et les initiatives à venir ne pourront pas faire l’économie de la dimension « temps ». Le moment de la reprise comme son organisation temporelle joueront sur la capacité de projection des acteurs et de ses unités éducatives dans l’après-confinement et l’avenir. Le discours de l’Institution et les espaces d’initiatives qu’elle laissera aux établissements seront, comme on dit, un signe fort : veut-elle, tolère-t-elle, refuse-t-elle que la situation d’aujourd’hui, soit aussi une opportunité positive pour faire bouger le système ?
Complexité, responsabilité
Les collégiens et les lycéens vivent actuellement une situation extraordinaire. Il en est de même pour leurs parents. La situation est plus diverse pour les plus anciens, certains ayant « connu la guerre », et parfois plusieurs. Il est question de morts, chaque jour apportant son bilan, plus lourd que celui de la veille, moins lourd que celui du lendemain, quand nous écrivons ces lignes. Des souffrances et des peurs sont dites, des dévouements voire des sacrifices également, des vols et des violences aussi. Il s’agit de sujets et de réalités dont nous ne parlons pas, dont nous ne voulons pas parler dans notre société dite de consommation hier, hédoniste aujourd’hui. La science infaillible ne sait pas, plus grave, les spécialistes se contredisent ! Et le Premier ministre qui doit pouvoir répondre de tout et avoir un avis sur tout a le courage de dire la vérité, « je ne sais pas », à propos de la maladie, parce que personne ne sait. L’imprévisible, l’incertitude, l’absence de maîtrise s’imposent. Ce sont les fondements de notre culture et de l’École qui sont mis en cause. La responsabilité de chacun est interpellée, chacun pouvant être contaminé et contaminant, victime et coupable. Avec la « distanciation sociale » (quelle expression curieuse !), c’est en nous éloignant d’elles que nous montrons aux personnes qui nous sont chères que nous tenons vraiment à elles. Message qu’il est difficile d’entendre dans une société de plus en plus fusionnelle, même si Internet nous permet de communiquer avec elles, jour et nuit !
Cette situation de « crise », relève de la pensée de la « complexité » qui a été introduite en France et développée principalement par Edgar Morin dans sa somme intitulée La Méthode, inaugurée dès 1977, le mot étant par la suite banalisé dans les usages, comme le mot « crise ». Elle nous incite à promouvoir une « éthique de la responsabilité » qui rendrait tout son lustre au mot « précaution », inscrit dans la Constitution depuis 2004, vulgarisé et dévoyé comme simple substitut de « prévention » le plus souvent. Au lieu de parler de façon nécessairement critique des injonctions paradoxales, affirmons ou, tout simplement, constatons que la vie des humains, des groupes, des organisations et des institutions est faite de tensions, de contradictions, de paradoxes et de dilemmes, de débats cornéliens ! Et encore plus pendant les crises. Oui, nous devons rester chez nous, et, oui, il faut bien que certains sortent pour soigner les malades ou pour alimenter notre supermarché puisque nous y allons. Faut-il utiliser tel médicament prévu pour d’autres pathologies contre le CODIV-19 ? Oui, puisqu’il a guéri des malades, même si nous ne savons pas s’il existera des effets secondaires, il y a urgence ! Non, puisqu’il peut y avoir des effets secondaires, la prudence s’impose ! Face à deux risques, les deux positions sont moralement acceptables. En d’autres termes, puisqu’il est question de finitude et d’incomplétude, la situation que nous vivons montre la nécessité d’une réflexion éthique qui a, nécessairement une réalité multiple, intellectuelle et psychologique, mais encore politique. Comment penser la crise ? Comment initier à la pensée de la complexité ? Que faire pour que les éducateurs que nous sommes tirent les leçons de cette période en vue d’une action de transmission à destination des élèves que nous voulons, disons-nous toujours, autonomes et responsables ?
Ouvertures
Les thèmes que nous avons privilégiés ne rendent pas compte à eux seuls de l’originalité de la période actuelle pour le système éducatif, plus précisément pour le secondaire, avec ce qu’elle a de violent et ce qu’elle a de motivant. A un moment où la photographie de la réalité est floue, ils font partie de ceux dont nous pouvons parler, à partir d’observations au demeurant partielles et, reconnaissons-le ! avec un discours moins neutre qu’il le faudrait. Il s’agit de points critiques en vue d’une analyse plus complète et plus construite, et surtout de points stratégiques incontournables dans la perspective d’une évolution du système éducatif dans sa relation à l’élève et à leurs apprentissages, via, conditions nécessaires mais pas suffisantes, la mobilisation des « minorités agissantes » évoquées, la mise en place, enfin ! d’un encadrement intermédiaire dans les EPLE, et la capacité des personnels de direction, une fois de plus en première ligne, à les mettre en place.
Alain PICQUENOT
Inspecteur d’Académie,
Inspecteur pédagogique régional (honoraire)
Établissements et vie scolaire (Académie de Normandie)