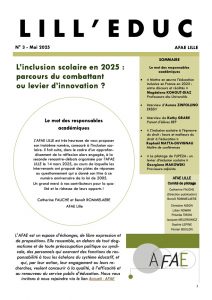Mois : mai 2025
“Comment l’indiscipline défie-t-elle les apprentissages scolaires ?” par Antonin CODUYS
Comment l’indiscipline défie-t-elle les apprentissages scolaires ?
Antonin CODUYS
Grâce à la multiplication des évaluations nationales et internationales, le système scolaire français a pu mettre en exergue, de manière statistique et objective, les difficultés rencontrées par les élèves dans les apprentissages, en particulier dans le domaine des savoirs fondamentaux[1]. Cette réalité est observée par les enseignants et les personnels de direction depuis plusieurs années au sein des EPLE[2]. Si le constat est désormais partagé, la recherche de l’origine de ces difficultés s’avère plus incertaine : irruption massive des écrans, baisse de l’écrit, uniformité des apprentissages, hausse des violences scolaires, insuffisance de la différenciation, etc. En partant du terrain et en s’appuyant sur notre expérience de chef d’établissement adjoint d’un collège de 600 élèves[3], on cherchera à explorer les liens entre certains comportements préjudiciables d’élèves, que l’on regroupera sous la notion d’indiscipline, et la baisse des résultats scolaires. Au regard de l’évolution des modalités d’encadrement des élèves, cette notion peut constituer une clef d’entrée dans l’interprétation de l’affaiblissement des performances scolaires. Les comportements que nous allons évoquer sont largement reconnus sur le terrain, notamment au collège, sans qu’il existe, pour le moment, d’indicateurs idoines permettant d’en mesurer avec précision l’influence. Au-delà de la mise en apprentissage des élèves, l’indiscipline agit sur les enseignants en accroissant la pénibilité de l’exercice de leurs missions.
Une notion complexe et polysémique qu’il s’agit de redéfinir
Mot polysémique, l’indiscipline tire son origine du substantif féminin latin disciplina, dont les premiers niveaux de sens sont éclairants : 1) action d’apprendre, de s’instruire ; 2) enseignement[4]. Ce faisant, la discipline apparaît d’abord comme liée à l’apprentissage, à l’instruction. C’est d’ailleurs ce sens que l’on retrouve aujourd’hui lorsqu’un professeur parle de « sa » discipline, c’est-à-dire son champ d’expertise dans le découpage de la connaissance. Il est utile de noter qu’un élève qui ne serait pas discipliné, dans cette acception, serait un élève qui refuserait d’apprendre. C’est au Moyen-Âge que le mot de discipline prend une tournure sémantique différente. Vers 1100 surgit une occurrence du mot dans le sens de « massacre » résultant d’un châtiment. Cette couleur violente et agressive s’installe ensuite dans le lexique religieux pour définir une « punition », un « châtiment corporel »[5]. Par métonymie, la discipline devient un fouet servant à la flagellation, c’est-à-dire un objet de souffrance qui sanctionne la non-observance d’une vie réglée.
Aujourd’hui, le mot a conservé de cet héritage latin le sens premier d’instruction ; ainsi, dit-on, « se mettre en discipline », c’est-à-dire se mettre à l’étude, en situation d’apprentissage. Toutefois, un deuxième sens, résultant du premier, a pris une place prépondérante, distinguant une règle de conduite imposée à autrui. De ce fait, pour s’instruire, il importe de suivre une règle de conduite définie. Dans le contexte du lexique scolaire, le mot d’indiscipline se démarque toutefois d’une série de termes cherchant à identifier les infractions aux règles communes, parmi lesquels on trouve d’une part, l’incivilité et la violence, et d’autre part, le climat scolaire.
En premier lieu, l’incivilité désigne le manque de savoir-vivre, de convenances, de courtoisie. Il dérive de l’adjectif latin incivilitas qui signifie « violent, brutal ». La civilité correspond donc au respect d’une série de normes morales qui encadrent la sociabilité, et marquent, par extension, un rapport à la qualité de citoyen, c’est-à-dire la civilité au sens latin. En milieu scolaire, l’incivilité s’apparente, par exemple, à des élèves qui ne disent pas bonjour, ne se lèvent pas en présence d’un adulte, répondent par des termes inadéquats, mettent les mains dans les poches, conservent leur bonnet à l’intérieur des bâtiments, etc. Le mot se met souvent au pluriel pour insister sur la répétition des infractions au code moral de la civilité.
De la même façon, le mot violence, qui signifie d’abord la force exercée pour soumettre ou contraindre quelqu’un, se met généralement au pluriel, dans une deuxième acception, pour désigner les actes d’agression commis contre quelqu’un ou quelque chose. D’autres niveaux sémantiques soulignent la relation de la violence avec la psychologie de l’être humain, en particulier avec l’expression brutale de ses sentiments. On qualifie ainsi la violence comme une intensité (d’une pulsion, d’un sentiment, d’une conviction). La violence est toujours une force excessive, brusque et impétueuse. A l’école, elle qualifie un acte grave, soit qu’il soit verbal, soit qu’il soit physique, ou bien qu’il porte atteinte à des biens. Il peut faire l’objet d’un signalement via l’application « Faits établissement » à la discrétion du chef d’établissement. Comme l’incivilité, la violence n’a pas de rapport direct avec l’apprentissage. Si elles peuvent toutes deux s’exercer en classe, elles ne s’inscrivent généralement pas contre l’enseignement prodigué.
Enfin, l’indiscipline se distingue de la notion de climat scolaire, laquelle reflète, avec une large perspective, le jugement que portent les parents, les élèves et les personnels sur un établissement scolaire. Cette notion renvoie ainsi à la qualité de vie à l’école. Elle peut concerner les normes, les buts, les valeurs, les relations interpersonnelles, les pratiques d’enseignement, le management, l’organisation de l’EPLE. Chaque établissement scolaire est engagé dans une démarche continue d’amélioration du climat scolaire à travers sept axes identifiés :
- stratégie d’équipe ;
- justice scolaire ;
- pédagogie et relation éducative ;
- coéducation ;
- prévention et gestion des violences et du harcèlement ;
- pratiques partenariales ;
- qualité de vie à l’école.
Plus précise, la notion d’indiscipline entretient un rapport étroit avec l’enseignement ; elle est à la fois plus lisible, mais également plus invisible, car produisant ses effets principalement dans les salles de classe, loin des atteintes éducatives graves telles que la violence scolaire. Écueil qui empêche la mécanique scolaire de fonctionner, affaiblit l’égalité des chances et nuit aux performances des élèves, l’indiscipline est une notion transversale qui appartient au climat scolaire sans toutefois s’y limiter. Elle permet de penser un phénomène répandu au sein des établissements scolaires, en particulier au collège. Ces comportements réfractaires face au travail scolaire et à la mise en apprentissage, dans toutes ses dimensions, participent d’un climat d’indiscipline qui affecte en profondeur les EPLE.
Une donnée omniprésente au collège, mais partiellement mesurable
Au sein des EPLE, l’indiscipline transparaît partiellement à travers les registres des punitions et des sanctions. Il faut cependant d’emblée écarter les faits graves de violence scolaire qui excèdent le périmètre de l’indiscipline. L’indiscipline s’exprime principalement au sein de la classe à travers des perturbations du déroulement du cours (interruption de la séance, insolence, bavardages, refus d’accomplir les tâches demandées, paresse, absence de matériel, cahiers non tenus proprement, etc.), mais également hors la classe (devoirs non faits, leçons non apprises). On peut donc estimer une partie de l’indiscipline à travers, par exemple, la récurrence des mots dans le carnet de liaison ou les heures de retenue.
Sur le plan national, la DEPP a mis en place depuis 2007 les enquêtes SIVIS[6] qui permettent de mesurer les faits graves déclarés chaque année par les chefs d’établissement. Parallèlement, depuis 2011, des enquêtes de victimation et de climat scolaire sont menées périodiquement. Entre 2011 et 2023, neuf enquêtes ont été réalisées. Dans la dernière enquête SIVIS parue en février 2024 (DEPP, NI, n° 24.04), 15,8 incidents graves pour 1000 élèves ont été déclarés au collège lors de l’année 2022-2023, en augmentation de 2,3 points par rapport à l’année précédente. L’enquête rapporte que 74% des incidents graves[7] ont lieu en collège. Par analogie, si la violence s’exerce principalement en collège, on peut estimer que l’indiscipline est également la plus marquée à cet échelon scolaire. Ce que confirment, par exemple, les données empiriques partagées entre pairs au sein des bassins d’éducation et de formation des chefs d’établissement.
Pour compléter l’enregistrement des faits graves, et mieux dépeindre le climat scolaire des EPLE, la dernière enquête de victimation (DEPP, NI, n° 23.08), parue en 2023, indique que 93 % des collégiens déclarent se sentir « bien » ou « très bien ». De la même manière, les données de la dernière enquête nationale contre le harcèlement scolaire sont assez rassurantes. 5 % des collégiens déclarent cinq atteintes ou plus sur le questionnaire. Ce qui rejoint les 6,7 % de collégiens se déclarant victimes de cinq violences ou plus dans l’enquête de victimation. Cependant, ces enquêtes, très utiles, ne rendent compte que partiellement de l’indiscipline. Elles visent surtout les relations interpersonnelles entre élèves et ne relatent pas les interférences du cours. Elles ne traitent donc pas de l’indiscipline en tant qu’objet d’étude.
Au sein des établissements scolaires, ce que l’on observe est la sous-comptabilisation de l’indiscipline dans les punitions et les sanctions. Devant la proportion d’élèves qui n’effectuent pas leur travail, qui ne possèdent pas leur matériel, qui n’exécutent pas les tâches demandées, ce sont seulement les faits les plus saillants qui sont punis (bavardages répétées, insolence, travail non réalisé à plusieurs reprises, etc.). Au bas de l’échelle de l’indiscipline, les phénomènes d’incivilité ne sont pas non plus mesurés. Ils constituent pourtant un terreau fertile qui nuit à la relation de respect envers les adultes. Comme la discipline contribue à une inhibition générale des élèves, à la plus grande maîtrise de leurs émotions, son affaiblissement contribue, par symétrie, dans le haut du spectre, à une répercussion sur le nombre de faits graves. Incivilités, indiscipline, violences, c’est toute une relation scalaire, interdépendante, qui se met en place et qui affecte les collèges, tant au point de vue des élèves que de leurs professeurs.
Une réalité au cœur du « malaise enseignant » et qui nuit aux performances scolaires
Alors que le bien-être des personnels est légitimement devenu une priorité institutionnelle[8], certains indicateurs ont identifié un « malaise enseignant », parmi lesquels la baisse des postulants aux concours de recrutement[9] et l’augmentation des démissions[10]. Plusieurs explications ont été avancées : les niveaux de salaire, le système des mutations, la hausse des violences scolaires, le manque de reconnaissance sociale, etc. A cela peut s’ajouter le facteur de l’indiscipline chronique. Selon le chercheur Pierre Périer, l’indiscipline favorise l’essor d’une « imprévisibilité pédagogique »[11], c’est-à-dire la nécessité pour les enseignants de devoir sans cesse « bricoler » pour réajuster le contenu d’une séance face à un auditoire indiscipliné. Dès lors, il devient malaisé d’anticiper sur la séance suivante, et même au-delà, de construire une progression pédagogique cohérente. Sans raison apparente, c’est ainsi qu’une séance « marchera » tandis qu’une autre, construite selon les mêmes préceptes, signera l’impossibilité d’enseigner. Cette « imprévisibilité pédagogique », facteur de pénibilité accrue, se traduit également, selon Pierre Périer, par l’impératif de « négocier » avec les élèves pour faire avancer la marche du cours et les placer en situation d’apprentissage. Le désarroi de certains enseignants face à l’indiscipline, que l’on peut observer au sein des établissements scolaires, aggrave un malaise sous-jacent et renforce un sentiment de perte de sens dans l’exercice du métier.
Du côté des élèves, le climat d’indiscipline affecte les performances scolaires, tant en nombre d’heures de cours perdues, qu’à travers le relâchement du travail personnel. Dans ce contexte, on constate l’influence de l’encadrement familial pour recentrer l’élève sur les savoirs scolaires. De ce fait, l’indiscipline agit tel un discriminant social en privant les élèves les moins accompagnés d’un climat propice aux apprentissages, érodant ainsi la mission première de l’École républicaine en matière d’égalité des chances (article L111-1 du Code de l’éducation). En classe, l’indiscipline prospère sur l’effet bien connu de l’imitation : lorsque plusieurs élèves négligent les tâches à réaliser, un groupe plus important finit par adopter cette nouvelle coutume d’inapplication. L’indiscipline affecte ainsi la progression des apprentissages sur deux plans : d’une part, elle multiplie, au sein de la classe, les sources de distraction pendant le cours, d’autre part, elle limite l’intensité et la qualité du travail personnel de l’élève.
À travers cette réflexion, nourrie par l’observation et traversée de multiples questionnements, on aura mis en lumière les relations sémantiques entre l’indiscipline et le travail scolaire pour faire émerger l’une des causes des difficultés des élèves face aux apprentissages. Difficilement mesurable, l’indiscipline ne relève pas d’outils traditionnels tels que les enquêtes SIVIS ou les enquêtes locales de climat scolaire. Le déploiement de nouvelles méthodes d’observation en classe pourra s’avérer utile afin de circonscrire ce phénomène avec précision, mais aussi d’établir un lien incontestable entre l’augmentation de l’indiscipline et l’affaiblissement des performances scolaires. Il s’agit d’un enjeu de premier ordre, car, outre la baisse des performances scolaires, le climat d’indiscipline ne favorise pas des conditions d’apprentissage idéales pour les élèves les plus fragiles. Clef de compréhension des enjeux de l’École d’aujourd’hui, la réflexion sur l’indiscipline peut servir à construire un socle à partir duquel renforcer les notions citoyennes de respect, de tolérance, de dialogue et d’empathie.
Antonin CODUYS
Principal adjoint
Collège Jean Jaurès à Nogent-sur-Seine (Aube)
[1] À titre d’exemple, les dernières données de PISA 2022 en « culture mathématiques » sur un panel d’élèves de 15 ans révèlent que, si la France s’établit avec 474 points dans la moyenne des pays de l’OCDE (472 points), ses résultats sont en forte baisse par rapport à 2012 (495 points) et que la part des élèves en difficulté augmente de 22,4 % à 29 %.
[2] Établissements publics locaux d’enseignement (second degré).
[3] Recrutement urbain et rural. IPS de 96,7. Indice d’éloignement de 106,1. Taux d’élèves boursiers de 25%. Milieux sociaux très favorisé et favorisé (29,5%), moyen (23,6%) et défavorisé (47%).
[4] Définition issue du dictionnaire français-latin, Le Grand Gaffiot, Hachette, 2000.
[5] Cette définition, ainsi que les suivantes, sont tirées du Trésor de la langue française informatisée (www.cnrtl.fr).
[6] Système d’information et de vigilance sur la sécurité scolaire.
[7] Les incidents graves désignent les violences exercées sur les personnes (verbales, physiques) ou sur les biens, ainsi que d’autres atteintes (laïcité, racisme, etc.).
[8] Comme en témoigne, par exemple, le sujet du concours interne des personnels de direction de 2023, à travers lequel il s’agissait d’élaborer une note de synthèse à partir d’un dossier « pour optimiser l’implication, la collaboration et le bien-être des personnels » au sein d’un EPLE.
[9] De 36 949 candidats inscrits et 19 342 présents à l’admissibilité au CAPES externe en 2017 à 20 755 candidats inscrits et 11 405 présents en 2024, soit deux baisses respectives de 43,83 % et de 41,04 %.
[10] De 364 départs d’enseignants en 2008-2009 à 2836 départs en 2021-2022, soit une hausse de 679 %, d’après le rapport « Enseignement scolaire » de M. le Sénateur Olivier Paccaud, rapporteur spécial (annexé au projet de loi de finances 2024).
[11] Pierre Périer, « L’ordre scolaire dans la classe : une négociation continue » in Négociations, 2012/2, n°18.
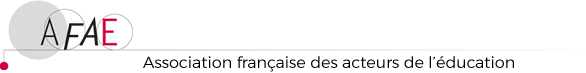


![LILL’ÉDUC n°3 [Académie de Lille]](https://www.afae.fr/wp-content/uploads/2025/05/LILLEDUC-n°-3-Mai-2025-AFAE-LILLE-copie-2.jpeg)