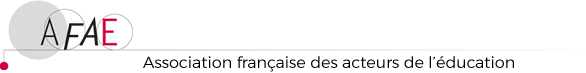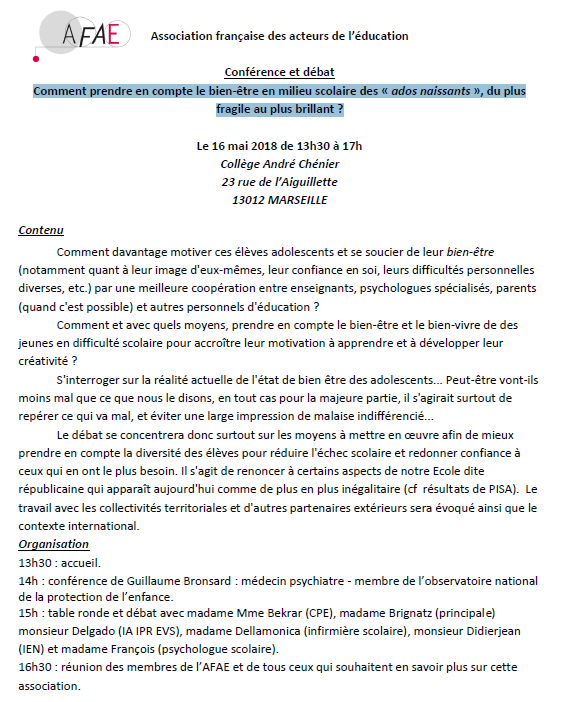De l’illusion du prescrit à la réalité d’un construit ou
Les territoires apprenants d’une circonscription
Bruno Bénazech, DAASEN Hérault
Ce texte est une contribution à la problématique des organisations scolaires apprenantes sous la forme d’un regard rétrospectif sur des actions mises en œuvre, de 2010 à 2017, lorsque j’étais inspecteur de la circonscription de Clermont Plaine, dans le Puy de Dôme, académie de Clermont-Ferrand.
La préparation de la mise en œuvre de la refondation de l’éducation prioritaire en 2013-2014, notamment la mise en place des 9 jours de travail collectif, et notre choix d’équipe de circonscription de développer des formations territorialisées, au sein des écoles, s’appuyant sur le travail en équipe, sont venus renforcer les dispositifs mis en place les années précédentes dans le cadre des 18h d’animations pédagogiques, que les enseignants du premier degré doivent réaliser chaque année scolaire.
En arrivant sur ce territoire, j’ai voulu prendre le temps d’en connaître les caractéristiques, les actions et assurer la continuité des orientations mises en œuvre par mes prédécesseurs, plutôt que d’engager des transformations comme certains conseils en management nous y encouragent, comme si ce qui n’est pas fait la première année ne pourra jamais être réalisé.
Cette circonscription est composée de deux réseaux d’éducation prioritaire renforcée et d’un secteur plus mixte qui comportait aussi de la difficulté scolaire, notamment par la présence de populations itinérantes et d’anciens quartiers urbains prioritaires politique de la ville. Les équipes menaient un travail intéressant et volontaire et l’objectif qui se dessinait peu à peu était d’améliorer les pratiques pédagogiques tout en s’appuyant sur un existant de qualité. Ce fut un premier acte d’un territoire apprenant que de ne pas changer de fond en comble ce qui existait et fonctionnait.
Pour revenir plus précisément sur la démarche collective engagée, avec l’équipe de circonscription, nous avons réalisé plusieurs constats au cours de la première année.
Le premier constat a été de s’attacher à repérer plus précisément les situations professionnelles que les enseignants affrontaient et qui éprouvaient et mettaient en question leurs outils et leurs connaissances. D’autant, qu’en les interrogeant et en analysant les plans de formations des années précédentes, il apparaissait qu’ils avaient été très nombreux à suivre, au cours des années passées, des formations sur les sujets fondamentaux de l’enseignement en éducation prioritaire renforcée.
De plus, l’analyse des compte-rendus d’inspection précédents, au fur et à mesure de mes visites en classe, lors de ma première année d’exercice, m’a permis de percevoir que des conseils pédagogique ou didactique pertinents avaient été formulés par mes prédécesseurs, que les enseignants pensaient en toute authenticité avoir cherché à les mettre en œuvre, voire même y avoir réussi, alors même que mes observations me montraient des pistes de progrès encore importantes. L’isolement du travail en classe et l’absence de regard réflexif ont conduit les enseignants à reformuler les conseils et à, peu à peu, les transformer pour les rendre compatibles avec leurs pratiques coutumières.
M.Polianyi explique le rôle de ce savoir tacite, acquis par l’expérience, de sorte que les acteurs ont une conscience limitée de son influence sur leur comportement et leur pratique. Ce savoir tacite n’est jamais réellement interrogé de manière régulière et outillée, bien au contraire, la pratique quotidienne trouvant les indices nécessaires à sa confirmation et à son renforcement. Et, les formations conçues de manière descendantes, sans questionnement des enseignants, pas plus que les conseils isolés, ne semblent pas avoir une quelconque influence sur ce savoir, ni même sur les enseignements.
Ces éléments, nous ont conduits, l’équipe de circonscription et moi-même, à rechercher ensemble des manières pertinentes de professionnaliser les enseignants plus efficaces et plus adaptées aux besoins et aux réalités rencontrées, sur leur territoires d’exercice.
La suite de ce texte essaiera de relater cette démarche tout en l’analysant et en la structurant sans pour autant en donner tous les détails. Vous pourrez en retrouver dans une monographie à paraître en mai 2018, sous la direction d’A.Bouvier et de S.Guillemette.
- Professionnaliser avec ou sans les enseignants.
Nous avons donc choisi de déployer un dispositif de formation qui redonne de la responsabilité et du pouvoir d’agir et de penser aux équipes. Nous avons conçu à partir de leurs demandes explicitées un dispositif filé de formation-accompagnement qui alterne, sur une ou plusieurs années scolaires, les moments de travail collectif formalisés, médiés et comportant des apports scientifiques, avec les moments de pratiques en classe, de partage et d’analyse entre pairs.
En ce sens, nous avons recherché une organisation du travail en circonscription qui prenne en compte ce que Wittorski nomme « une intention de mise en mouvement des sujets dans les systèmes de travail par la proposition de dispositifs particuliers » (professionnalisation et développement professionnel, 2007, L’Harmattan, Paris).
Il nous est apparu très rapidement que le fait de réfléchir en équipe d’école (ou de plusieurs écoles sur un même objet) modifiait les règles d’action collectives dans l’organisation et les pratiques de chacun au sein de sa classe. Cela permettait « la réappropriation par le salarié de son expérience et le développement d’une certaine conscientisation de ses capacités. »
Ainsi, cet ancrage plus fort des actions de formation dans les situations de travail contribuait à donner du sens à la formation en circonscription et renouvelait l’activité des conseillers pédagogiques, tournée de plus en plus vers le développement professionnel continu et de moins en moins vers de la gestion de crise immédiate.
- Trouver des solutions aux questions professionnelles qui se posent dans le travail enseignant.
Pour poursuivre cette réflexion, nous reviendrons sur les rencontres effectuées avec les enseignants et les directeurs des écoles au cours des premiers mois dans la circonscription. Ils montraient une certaine lassitude face aux discours de rupture récurrents qui justifient bien souvent les changements.
Les équipes se sentaient peu à peu déqualifiées par des propos qui laissaient à penser que rien ne fonctionnait correctement dans les écoles et que les élèves apprenaient bien peu de choses. Les enseignants avaient le sentiment que leurs savoirs professionnels étaient remis en cause et que bien souvent ils n’étaient pas efficaces, alors même qu’ils voyaient les progrès de leurs élèves et que personne ne prenait réellement en compte les problèmes qu’ils rencontraient dans leur enseignement.
La démarche engagée a donc visé dans un premier temps à prendre en compte les réalités du terrain en s’attachant à donner de la valeur et du sens au travail quotidien des enseignants, conçus comme les acteurs centraux de ce territoire scolaire.
Il nous semblait qu’une démarche apprenante ne fait pas table rase du passé et des acquis et qu’il était indispensable de s’appuyer sur les savoirs des équipes et des enseignants, de repérer les questions professionnelles qu’ils se posaient et de les articuler aux orientations nationales et au projet académique. En ce sens, les conseils généraux ou les notes de service globales ne pouvaient pas avoir d’incidences réelles sur le travail des équipes.
Il s’agissait alors de chercher à transformer modestement, progressivement et durablement les pratiques pour construire avec les enseignants des solutions pérennes aux problèmes rencontrés. Nous avons privilégié une démarche collective de la lame de fond, plus lente mais plus massive, à une démarche individuelle de la déferlante dont l’écume finit même par disparaître dans la vague.
Nous avons repéré les formateurs potentiels (ESPé, Conseillers pédagogiques, maître formateurs, enseignant du supérieur …) et nous les avons sollicités. Un temps de présentation du dispositif et des attendus a permis à chacun d’eux de percevoir que ses savoirs scientifiques, universitaires et de formateur n’étaient pas requis pour une diffusion « traditionnelle » sous une forme de conférence mais bien pour être traduits et intégrés dans les questions professionnelles que les enseignants se posaient.
Il ne suffisait pas de venir avec des outils et des connaissances « prêtes à l’exposition », voire avec une séance toute prête sur un sujet d’expertise, il fallait surtout adapter ces propres ressources aux situations vécues par les équipes.
Au cours de chaque dispositif de formation, dont les sujets étaient définis conjointement entre les équipes enseignantes des écoles, les formateurs, l’équipe de circonscription et l’inspecteur, les réalités du terrain étaient questionnées donnant de la valeur et du sens au travail quotidien des enseignants, et permettant d’identifier les leviers de transformations possibles et les modalités de mises en œuvre de ces évolutions dans les gestes d’enseignement quotidiens.
Avec l’appui des différents formateurs qui sont intervenus, nous avons voulu transformer les formes d’enseignement et de formation entre pairs. Nous voulions que se construisent au sein des équipes des formes de collaboration adaptant les postures face aux problèmes que les enseignants rencontrent régulièrement. Questionner le réel était le moyen de permettre aux enseignants d’incorporer dans leurs savoirs et leurs pratiques, de nouveaux process du métier étayés par la science, outillés par des scénarios possibles et explicités par tous les acteurs, qu’ils soient inspecteur, conseiller pédagogique, enseignant des universités, formateur de l’ESPé … pairs.
- Des expertises pour accompagner la réflexion et la construction d’outils
Ainsi, une fois les contenus de formation identifiés avec les équipes des écoles, il nous fut nécessaire de recourir à des formateurs en capacités de travailler les objets de formation repérés et aussi capable de pouvoir négocier les contenus puis accompagner et soutenir les équipes tout au long de l’alternance formation/travail collectif-mise en pratique/expérimentation. Pour cela nous souhaitions, qu’autant que faire ce peu, les démarches de construction de nouveaux process d’actions, de nouveaux gestes-métier soient orientées par l’analyse des besoins des élèves et des procédures que ceux-ci mettaient en œuvre au cours des séances d’enseignement. Observer les apprentissages pour agir.
Lors des séances de formation, la présence en continu d’un formateur-accompagnateur, a permis d’envisager plusieurs postures soutenant l’évolution des pratiques et des savoirs des enseignants : « un tiers formalisant », un apport de savoirs scientifiques, un apport d’outils et/ou une mise à distance des pratiques personnelles.
Le directeur de l’école, pour sa part, avait la responsabilité de l’animation pédagogique globale du projet d’école et donc des échanges et du travail collectifs qui ne manquaient pas de résulter des essais développés. Certains furent soutenus par les conseillères pédagogiques, souvent à leur demande et parfois sur ma proposition, voyant les difficultés qu’ils pouvaient avoir à diriger des échanges et des réflexions pédagogiques, dans lesquels ils étaient aussi impliqués.
Plusieurs logiques de professionnalisation se sont jouées dans ces activités selon les objets de travail et les finalités voulus par chaque équipe d’école. Elles ont permis des progrès professionnels durables et transmissibles entre les enseignants d’une même équipe et aussi entre écoles, contribuant dans la durée à une dimension apprenante du territoire. Elles ont nourri la réflexion collective dans la circonscription et fait évoluer les projets de réseau, que ce soit les projets formels tels que les projets des REP+ conçus avec les équipes des collèges ou les projets inter écoles, tels que celui sur l’enseignement de la compréhension en maternelle ou celui sur la manière de concevoir la première scolarisation en maternelle, ou encore les projets inter REP+ sur le co-enseignement PE-PLC, en CM2-6ème.
Pour reprendre les catégorisations de Nonaka et Takeuchi (1997), nous dirions que les logiques en jeu ont pu permettre de passer des « connaissances tacites » aux « connaissances explicites », de socialiser au plan professionnel en allant d’un tacite à un autre tacite ; d’intérioriser des démarches pédagogiques ou didactiques en cheminant d’explicite à tacite ; d’extérioriser ses propres mises en œuvre se déplaçant du tacite à l’explicite et bien sûr par une combinaison de ces logiques, d’explicite à explicite. Ces différentes logiques contribuent chacune à la construction d’un réseau professionnel et des gestes métiers qui en font l’essence. Cependant, un réseau apprenant suppose aussi de structurer la mémoire des savoirs et des compétences, leurs transmissions et diffusions entre pairs et leurs adaptations futures à l’évolution des situations et des contextes.
Enseigner est pour nous non seulement un métier de la connaissance mais aussi un métier de l’intelligence, un métier de « l’apprenance » et qu’en ce sens, le meilleur moyen de le maîtriser, de l’enrichir, de le développer et de le rendre excellent est de le nourrir par « l’exercice de la pensée sur le travail ».
- Faire confiance, partager du commun, développer des compétences, s’appuyer sur un collectif
La démarche a consisté pour l’inspecteur que j’étais à ne pas sur-prescrire mais à encourager à essayer, à prendre des risques réfléchis et étayés, à présenter ses essais, ses erreurs, ses réussites, à en déduire des actions efficaces, des formes de travail avec les élèves, à préciser selon les objectifs et les attendus le contenu des séances, l’enchaînement des situations, les types et modalités d’intervention de l’enseignant …
Nous ambitionnions clairement le développement de compétences professionnelles de haut niveau dans un métier complexe : des compétences d’action, des compétences d’analyse des situations et des compétences de gestion de l’action.
Nous visions par ce travail collectif des savoirs partagés, que les équipes construisent du commun professionnel explicite, reconnu et argumenté.
Nous espérions parvenir à faire évoluer les cultures de travail qui peuplent le métier. Celles-ci peuvent se décliner en différentes catégorisations. Beaucoup d’enseignants cultivent une forme proche de l’artisanat-savant, avec des compétences propres, incorporées fortement aux situations vécues, aux expériences constituées, aux représentations du métier, à la personnalité.
Il nous semble que la taille de l’éducation nationale, le nombre considérable d’enseignants, de classes, d’élèves peut aussi rapprocher les pratiques et les organisations de certaines formes que nous trouvons dans l’industrie et notamment celles qui relèvent de la taylorisation des tâches et de la re-taylorisation des pratiques, de plus en plus éloignées du collectif nécessaire au projet éducatif qui consiste à « instituer l’humanité dans l’homme ». La classe, une sorte de cellule close, et l’absence de temps institutionnalisé de discussion métier (en dehors de la « pondération » en REP+) contribuent à séparer plus ou moins strictement les actions d’enseignement de chacun et surtout à rendre son propre travail invisible à ses pairs, pour ne pas dire caché.
Enfin, nous voulions ouvrir cet univers replié souvent sur lui-même en constituant progressivement au sein des écoles, et aussi par des réseaux d’équipes ou d’écoles signifiants (par exemple, les enseignants impliqués dans le dispositif plus de maîtres que de classes, les enseignants impliqués dans la première scolarisation des élèves de 2/3 ans …), un système d’expertise collectif territorialisé.
Nous pensons que le recours aux concepts, aux modalités et aux formes des organisations apprenantes est actuellement le plus adapté pour parvenir à exploiter au mieux les différentes cultures de formation nécessaires : culture de l’enseignement, culture de la formation, culture de l’accompagnement, culture du développement professionnel et en facilitant aussi l’accès aux cultures de recherche.
Il nous semble indispensable de faire confiance car, quoiqu’il en soit, aucun inspecteur ni même aucun cadre du système n’est en capacité d’être derrière chaque enseignant pour l’observer et le guider dans son activité quotidienne. La réalité est bien différente et chaque enseignant, chaque équipe, chaque collectif doit être formé pour pouvoir résoudre les situations qu’ils rencontrent et réussir à faire apprendre à tous les élèves l’ensemble des compétences du Socle commun.
Nous sommes donc convaincus que les progrès dans les apprentissages des élèves ne peuvent s’espérer que par la montée progressive et continue en compétences collectives des adultes qui en ont la charge. Nous sommes aussi convaincus que la mise en œuvre d’organisations apprenantes au sein des territoires éducatifs est aujourd’hui une manière ambitieuse de construire de la socialisation professionnelle. C’est peut être aussi une manière de pouvoir in situ, sur les lieux même de l’exercice du métier, de penser la transmission des savoirs d’expérience maîtrisés par les plus anciens aux plus jeunes qui arrivent dans le métier.
C’est un métier trop souvent isolé, exercé dans des architectures de la clôture et non de l’ouverture, dans des temps successifs et trop rarement partagés, dans des objectifs immédiats, du programme de l’ici et maintenant, là où la construction d’un citoyen éclairé ne peut qu’être qu’un objectif de développement durable par des collectifs qui en dressent ensemble les chemins, avec détours et contours.
Enseigner c’est se préoccuper des autres, transmettre ses savoirs, ses outils et ses méthodes au plus grand nombre. C’est un exercice du don sans cesse répété dans lequel l’usage de soi est le plus souvent requis pour porter attention aux autres. C’est faire confiance dans les potentialités de chaque enfant, de chaque jeune à appendre et à progresser de manière continue. C’est aussi travailler avec ses collègues en confiance et dans la controverse professionnelle.
Etre cadre du système, c’est d’abord, savoir observer, écouter et entendre. C’est ensuite, faire confiance dans les potentialités de ses collaborateurs, de ses partenaires, de chaque enseignant à répondre aux enjeux du système. C’est préférer mobiliser la richesse des capacités collectives à l’unicité de pratiques clonées. C’est s’engager sur le chemin de la professionnalisation des acteurs, de la structuration des organisations et du recours aux experts et aux expertises. C’est permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même en prenant toute sa place dans les mises en œuvre territorialisées des politiques publiques d’éducation.